Voyage en Palestine,
1909.
En 1909, muni d’un laissez-passer
français et d’un passeport égyptien, Auguste François, auteur des notes
ci-dessous, qui avait cessé son activité professionnelle effectua avec son
épouse une croisière touristique en Méditerranée orientale : Egypte,
Palestine, Turquie.

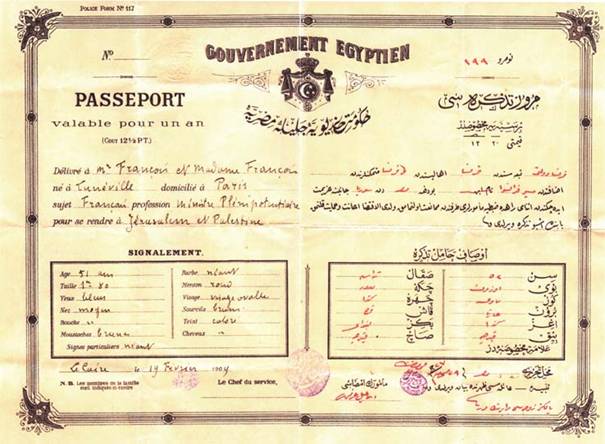
Dimanche, 21 février 1909
Nous quittons le Caire, ce Dimanche gras. En quatre
heures d'un train express marchant comme un omnibus, nous sommes à Port-Saïd.
Nous traversons d'un galop rapide les rues bordées des édifices en planches de
caisses d'emballage et fer blanc de boîtes de conserves datant du percement de
l'isthme, et pavées en fiente de chameau, animées d'une manière inaccoutumée.
Nous nous heurtons en effet à un cortège de masques escortant un char
représentant une monumentale bouteille d'absinthe, admirable emblème du
commerce principal de cette guinguette à matelots qu'est ce port dénommé Saïd.
J'aurais cru que dans ce lieu de perpétuelle mascarade il n'était pas besoin de
saison spéciale pour produire ces chienlits.
Nous voici au quai. La mer est belle. On nous prédit un
débarquement assuré à Jaffa, pour le lendemain.
En quelques coups de rames, nous allons accoster le Kosseïr.
Ce bateau de la "Kédivieh" est sale et puant plus qu'il ne devrait
être permis à une compagnie, même égyptienne. Et celle-ci navigue cependant
sous pavillon d'Angleterre. Quelle marchandise a bien pu couvrir ce
pavillon ! En outre, on ne peut s'y retourner. On y a entassé plus de
passagers que les cabines n'en peuvent contenir, et de plus encore, ces cabines
qui possèdent un nombre impair de couchettes obligent à une séparation des
ménages en exigeant une répartition par sexes. Ceci me rappelle une traversée
d'autrefois sur les mêmes paquebots où pareillement on acceptait plus de gens
qu'on n'en pouvait loger et où, en fait de lit, je partageais la table de la
salle à manger avec deux religieuses de Saint Vincent de Paul envoyées chez les
"Teurs". Et après un tel précédent, on me sépare de ma femme, laquelle
est condamnée à s'accommoder du voisinage d'une Anglaise grincheuse et d'une
Américaine qui conduit son petit chien en Terre Sainte - car on voit de suite
que cette dame voyage avant tout pour son loulou de Poméranie.
Enfin, la mer est tellement calme qu'on supporte sans
trop de peine cet entassement. Le Kosseïr ne bouge même pas.
Lundi, 22 février 1909

Jaffa vue de la mer

Navires devant la passe de Jaffa
Vers les sept heures du matin, nous sommes devant Jaffa
et on nous invite à nous faire visiter par le représentant de la
"Santé" turc. Une visite sanitaire de passagers d'Europe dans ce
conservatoire de la peste et du choléra, c'est un comble ! On nous parque dans
un coin du pont où un médecin à fez, crasseux, joue la comédie d'une inspection
en nous faisant défiler devant lui.
Nous sommes reconnus sains et aussitôt le paquebot est
pris d'assaut par des bandes de bateliers qui arrachent littéralement les
passagers et les déposent dans leurs barques tout comme paquets.
Nous franchissons sans difficulté la ceinture de brisants
qui interdit toute communication avec la terre aussitôt que le moindre vent du
nord lève un peu de mer. La seule passe libre dans cette ligne de roches est en
effet si étroite qu'une barque ne peut s'y couler qu'en rentrant ses rames qui
toucheraient aux deux parois.
De l'autre côté, nous voici au bas d'un appontement de
bois sur lequel nous sommes hissés avec le même traitement de colis que pour
débarquer du paquebot.
Un bakchich supprime les formalités de l'entrée de nos
personnes et de nos bagages sur le territoire turc et nous voilà dans une
ruelle sordide, entre des baraques lépreuses, sur un pavé défoncé et gluant.
Allons, la Turquie n'a pas changé. Et pourtant, ce qui frappe tout de suite,
dans cette ruelle turque, ce sont les enseignes allemandes. Partout c'est des
"Kaiserlich Post", des "Deutsch Apoteke", des "Herr
Doktor" Untel, des "Deutsch" offices ou bureaux, partout des "Deutsch"
quelque chose, en larges caractères gothiques. On a l'impression de débarquer
dans une annexe de l'Empire.
Un instant de repos sous les ombrages de l'Hôtel du Parc
- allemand bien entendu - et nous montons en voiture pour l'excursion classique
à la maison de Tabitha, qui doit remplir le temps d'attente du train de
Jérusalem. Les personnes à qui ce nom de Tabitha ne rappellerait rien voudront
bien se reporter au Nouveau Testament, ou bien au Bædeker.
En route, nous faisons connaissance avec les premiers
Bédouins, des gens très pittoresques de types et de costumes, avec leurs
gandouras en grossière étoffe rayée brun et blanc et leur voile retenu sur le
haut de la tête par une épaisse corde en poils de chameau. Seulement, dans cet
exotisme, voici une note criarde, si j'ose ainsi dire. Un de ces Bédouins que
nous croisons sur le chemin qui va à Jérusalem transporte un superbe
phonographe.
La maison de Tabitha est actuellement la propriété d'un
couvent russe. Elle fait partie d'un vaste enclos sur une colline dont le
sommet est occupé par une église de rite orthodoxe. Du haut de la tour de ce
monument, la vue s'étend sur un vaste panorama avec la mer pour fond d'un côté,
la côte bordée des maisons de Jaffa de l'autre côté ; vers l'intérieur ce ne
sont que des orangers et toujours des orangers, pressés en taillis touffus, une
masse de vert sombre, piquée d'innombrables points jaunes.
Tiens, tiens, tiens, mais cette Palestine ne ressemble
guère à ce que j'en attendais.
En rentrant vers la ville, nous ne voyons qu'oranges
qu'on cueille, qu'on emballe et que des chameaux transportent dans des caisses
qui les couvrent tout entiers.
Mais quelle course en voiture, dans cette banlieue de
Jaffa et quelles routes ! On n'a pas idée en Europe, de lancer une honnête
victoria à un pareil galop et dans des ornières semblables. Notre Allemand
d'hôtelier m'apprend que les ressorts de ces voitures viennent de France et je
me sens fier de la carrosserie de mon pays.
Dans la vieille ville de Jaffa, dont les ruelles
escaladent une colline fort raide, il faut aller à pied, grimper le plus
souvent sur des escaliers. La surprise continue agréablement ; je redoutais la
banalité d'une ville maritime d'Orient et je n'accédais qu'avec répugnance à
l'offre de notre guide de circuler parmi ce que je pensais être des rues
simplement sales et sans caractère et, pas du tout. C'est pittoresque en diable
; pas un détail qui choque, pas de chapeaux melons sur des têtes d'indigènes,
pas de vestons crasseux. Hommes et femmes ont le costume national complet. Dans
les ruelles serpentines les ordures sont bien à leur place et telles qu'il faut
les souhaiter pour l'effet décoratif. Les maisons s'arc-boutent les unes aux
autres par des moitiés ou des quarts de cintres, curieusement appliqués. A tout
instant ce sont des escaliers, des voûtes, des échappées de vue sur la mer dans
des encadrements de portes. Le mot bakchich est rare. Bravo la Palestine !
Après déjeuner, nous prenons le train qui s'en va
cahin-caha entre des bois d'orangers, des bois d'oliviers, abritant de leur
ombre des cultures diverses. Puis c'est une campagne nue avec de beaux champs
de blé. Partout dans la verdure, d'innombrables fleurs rouges d'anémones
sauvages. Enfin le terrain devient pierreux, montueux et on entre dans une
gorge étroite. La voie serpente, la locomotive s'époumone à monter raide dans
ce couloir de roches blanchâtres et il en va ainsi jusqu'à Jérusalem.
Il est cinq heures quand nous arrivons. De la gare à la
ville la distance est d'environ deux kilomètres jusqu'à la porte de la
citadelle sur le mont Sion. L'hôtel Fast est tout proche et en dehors des murs.
Une voiture nous y conduit à une allure vertigineuse avec des cahots qui font
quitter la banquette et on penche d'une façon inquiétante. De suite nous avons
une vue sur la citadelle ; le soleil couchant éclaire une ligne de remparts
blancs s'élevant sur des rochers blancs. Tout cela a une allure, une couleur,
ah mais, c'est autre chose que l'Egypte, cette Palestine !
Quand nous défilons le long de la fortification, une
foule immense de peuple aux vêtements éclatants de couleurs - au moins cinq à
six mille individus - sont assis au-dessous de la muraille, sur les talus qui
dominent la route. Celle-ci est elle-même encombrée de gens et d'animaux,
chameaux, ânes. Cette affluence, nous explique-t-on, est causée par la
coïncidence du premier jour du Carême grec avec le premier jour du Carnaval des
autres rites. Il en résulte que notre entrée dans Jérusalem se fait au milieu
de nègres costumés en Pierrots, montés sur des ânes.
Notre attelage escalade au galop un des versants du mont
Sion et, à mi-côte, s'arrête devant l'hôtel Fast. Derrière une sorte de
comptoir, un bon gros Allemand à lunettes, assis au-dessous d'un aigle
empaillé, entre des bocaux où des serpents baignent dans de l'alcool, me donne
l'illusion d'entrer dans une pharmacie. C'est le bureau. Des deux côtés du
vestibule s'alignent des vitrines où des marchands indigènes exposent des
objets de piété, des chapelets, des croix de buis et de nacre. Je jette en
passant un coup d'œil sur cette pacotille et aussitôt un objet attire mon
attention tant il me parait insolite de le rencontrer ici et en pareille
compagnie. Je le prends pour l'examiner ; plus de doute, c'est bien un marteau
en buis, de la forme particulière des marteaux de maçons et, pour qu'il n'y ait
pas de méprise possible sur sa destination, un triangle et une équerre sont
sculptés sur une face ; sur l'autre face il est écrit "souvenir de
Jérusalem". L'emblème des vénérables ... [frères trois
points] dans la ville sainte, fraternisant avec les objets de piété ! C'est un
comble ! Le marchand m'assure que c'est d'une vente très courante et que les
Américains en achètent beaucoup.
Mardi, 23 février 1909
Un vent qui s'est levé dans la nuit souffle ce matin en
tempête. On ne débarquerait pas aujourd'hui à Jaffa. Des nuages noirs
s'amoncellent ; nous allons évidemment refaire connaissance avec la pluie. Vite
nous nous dirigeons vers le saint sépulcre où nous parvenons par une série de
petites rues étroites dont certaines sont couvertes, voûtées et sombres. La
circulation y est difficile dans la foule des gens à fez et à turban, des
Bédouins aux têtes cerclées de cordes, des femmes voilées de blanc, des Juifs
crasseux aux lévites de velours râpées et coiffés soit de bonnets noirs
coniques, soit de chapeaux plats presque identiques à ceux de nos Bretons, qui
laissent pendre des boucles de longs cheveux tortillés, huileux, encadrant des
visages de sémites aux yeux faux, et des nez ! Le voilà le Juif immonde se
glissant dans la foule et contrastant vigoureusement de type, de costume et
d'attitude, parmi les Turcs et les Bédouins de belle race saine et de fière
tenue.
A mesure qu'on approche du saint sépulcre, on croise des
pèlerins russes, types classiques du bon moujik, large casquette, enfoncée
jusqu'aux yeux, d'où déborde une toison généralement fauve, tombant jusqu'aux
épaules ; des redingotes usées, luisantes, aux longues basques plissées à
petits plis ; des bottes de cuir ou de feutre gris, larges comme des bottes
d'égoutiers, éculées, trouées, ou bien encore des semelles de corde sous des
pieds emmaillotés de chiffons serrés par des ficelles jusqu'aux genoux. Leurs
femmes viennent aussi par bandes, un mouchoir sur la tête, une pauvre grosse
jupe toute en loques, des loques ficelées aux jambes, beaucoup s'appuyant sur
une longue canne. Et c'est sale, tout ce monde ! On devine la vermine. Ils
déambulent pesamment, gauchement, comme du bétail en troupeau, avec des regards
de bêtes égarées.
On quitte une rue voûtée, on enfile un couloir à ciel
ouvert, descendant par des degrés de pierre sur une petite place, plutôt une
cour, où se tient un poste turc. C'est le parvis du saint sépulcre. On pénètre
dans la basilique par un double portail à deux cintres, bas et dont les restes
architecturaux sont très délabrés. A gauche en entrant, un poste de gardiens
indigènes ; allongés sur un lit de camp, ces gardiens à turbans sirotent
confortablement du café.
Je n'entreprends pas de décrire le monument dans ses
détails ; je ne veux que rapporter l'impression qui se dégage de cette première
visite. Tout ce qui a été dit de Jérusalem vous est déjà parvenu ; il semble
qu'on ne doit pas éprouver de déception, et pourtant, tout ce que les yeux
perçoivent dès les premiers pas procure une impression plus pénible qu'on ne
l'aurait pensé. Ce qui s'impose à l'esprit, ce qui excite de suite une
indignation qui ne fait qu'aller en augmentant et qui interdit tout autre
sentiment, c'est le dépècement scandaleux de ces lieux saints, leur
exploitation par les différents rites qui se sont arraché des morceaux du sol,
comme on aurait pu faire du vêtement du Christ tiré en tous sens et dont chacun
aurait un lambeau. C'est la rivalité haineuse de tous ces Chrétiens, grecs,
arméniens, coptes, syriaques, maronites, abyssins, etc., qui se réclament du
Christ.
Sur un espace de moins de six mètres, des autels se
dressent les uns contre les autres, que ces Chrétiens ennemis défendent à coups
de trique et parfois à coups de feu. L'un a accaparé l'endroit où la croix fut
plantée, l'autre s'est saisi du terrain sur lequel la croix fut déposée ; un
troisième occupe la place où la vierge s'est tenue ; et ces six mètres carrés
sont territoire des Grecs, des Catholiques romains et d'autres encore.
Mais parmi tous, ce sont les Grecs et leurs popes qui,
par leur fourmillement, leur arrogance et leur audace, vous irritent davantage.
On ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux, que leurs beuglements et leur musique
énervante ; ils s'agitent, vont, viennent sans cesse, dans leurs costumes de
magistrats, toge noire, toques noires très hautes, le plus généralement
crasseux, des cheveux bouclés ou roulés en chignon. Il en est d'aspect
repoussant, vermineux, avec des airs d'oiseaux de proie perchés sur un cadavre.
Ces Grecs ont volé un grand coin de la basilique des Croisés ; ils ont même
dépossédé ceux-ci de leurs tombeaux qui leur ont servi de support aux murs du
temple qu'ils ont construit sous la coupole même, contre le sépulcre. Là ils
ont entassé les images, les dorures, les cadres, l'or, l'argent, tout un
clinquant qui fait encore mieux ressortir leur pouillerie personnelle. Et tout
le long des jours et même des nuits, ils beuglent en face de ce malheureux
sépulcre, y apposant ou dépendant leurs oripeaux et leur ferblanterie.
Les bonnes bêtes de moujiks vont naturellement à cette
cathédrale des Grecs, puisqu'ils appartiennent au même rite. Mais leurs popes
russes ne peuvent y officier seuls ; ils doivent être flanqués d'un des prêtres
grecs exploiteurs de cette entreprise, car ce n'est réellement pour eux que
l'exploitation d'une scandaleuse entreprise de dépouillement.
Ces pauvres pèlerins russes arrivent ici par milliers,
conduits comme troupeaux, logés dans de grands caravansérails et vivant d'une
vie ultra économique. On les rencontre tout le long des journées, partout où il
y a des pierres à baiser, apportant leur foi d'une extrême naïveté, leurs
pratiques qui touchent à l'idolâtrie et laissant leurs misérables épargnes aux
doigts crochus des Grecs qui leur vendent jusqu'aux balayures des lieux saints,
des raclures de cire, et leur font payer des certificats qui leur serviront de teskérés,
passeports pour le ciel. Ils entrent et, dès le seuil, ils se prosternent
lourdement, le front sur la pierre ; ils se relèvent, la tête renversée, les
yeux au ciel, leurs longs cheveux leur faisant comme une auréole, en extase, et
ils se mettent à lancer vingt fois, quarante fois, de grands signes de croix
qui frappent et sonnent comme des coups de poing sur leur poitrine. Puis ils
errent dans la basilique, se reprosternent et se signent dans tous les coins,
baisent toutes les murailles ; ils lèchent littéralement toutes les pierres et
le sol. A l'entrée du sépulcre c'est un écrasement pour passer sous la porte si
étroite et si basse qu'on ne peut la franchir que ployé, presque à genoux. Là,
les femmes russes gémissent sous l'émotion ; elles ne peuvent s'arracher de
place et elles s'en trouvent rejetées par le flot qui les presse du dehors.
A côté de cette ferveur, passent les groupes
d'Américaines qui visitent ici comme elles font aux tombeaux de Pharaons, sous
la conduite des gens de Cook, débitant leurs boniments. Des mendiants vous
accrochent ; des Bédouins se promènent, des soldats (...)
En sortant de la basilique, si l'on tourne à droite sur
l'emplacement des anciens établissements et du cloître des chevaliers de Saint
Jean, on entre dans une construction solide, lourde, architecture des gares
d'outre-Rhin, et c'est en effet allemand. Ce lieu a été annexé par le kaiser
pour un temple protestant. Il y est écrit en lettres d'or que, au nom du
Seigneur du ciel, lui, le seigneur kaiser et roi dont le nom est écrit en
capitales égales à celles du souverain du ciel, a édifié ce monument au Saint
Sauveur. C'est ici que Guillaume est venu officier, consacrer en qualité de
pape des Allemands. Evidemment, dans la comédie burlesque de Palestine, ce
cabotin ne pouvait manquer. Depuis cette chevauchée en casque et burnous, les
Allemands se sont jetés sur la Judée comme sauterelles. J'ai devant moi en
écrivant, un Guillaume à moustaches terribles, peint en bleu. J'en ai un autre
dans le dos, en blanc et en cuirasse. Il y en a dans tous les coins. Il est sur
les affiches de tous les produits allemands, dans toutes les rues.
Après le déjeuner, je passe chez notre consul général.
Gueyrault me confirme dans mon impression. Je ne me suis rien exagéré, loin de
là. Précisément les Grecs viennent de soulever de nouvelles difficultés entre
eux et leurs adhérents arabes. Ceux-ci voudraient avoir une part de contrôle
sur les opérations du synode grec et les membres de ce synode leur refusent
tout représentant. D'où effervescence, échauffourées : plusieurs morts, dont un
prêtre étranger. Le patriarche grec ayant paru favorable aux Arabes est déposé,
sommé de s'en aller. Comme il refuse, le synode s'adresse aux Turcs pour
l'expulser. Mais voici que les soldats turcs manifestent l'intention de prendre
parti pour les Arabes. Les autorités musulmanes sont très gênées ; elles ont
appelé le vali de Damas. Constantinople a envoyé plusieurs pachas, un général,
douze cents hommes de renfort. Le synode ayant nommé d'office un autre patriarche,
celui-ci meurt subitement dans la nuit : mauvais café, on le présume.
Au moment où j'écris, des vociférations éclatent sous nos
fenêtres. Une bande d'indigènes réclame le vali et l'interpelle violemment.
Renseignement pris, un prêtre grec, un certain Germanos, vient de tirer sur des
Arabes chrétiens partisans du patriarche ; il en a tué trois. La foule crie
vengeance et veut l'arrestation du meurtrier.
Le vali se promène flegmatiquement dans le hall devant
moi, sans répondre.
Devant la fenêtre du balcon où je suis allé contempler la
scène, des gens discourent avec de grands gestes théâtraux à l'adresse du vali.
D'autres hurlent et frappent le sol avec fureur de leurs grosses matraques
recourbées. Enfin, pour mieux attirer l'attention du vali, trois coups de feu
retentissent. Des dames se sauvent, très effrayées. Nasim Pacha, toujours
ambulant, les mains derrière le dos, prononce en pur français : "N'ayez
pas peur, Mesdames, ce n'est rien. Ce sont des gens qui sont trop gâtés. Ils
veulent seulement attirer mon attention". Et c'est d'ailleurs toute
l'attention qu'il donne à l'incident.
Mercredi, 24 février
Il fait un temps de chien : pluie et vent, au dehors une
boue affreuse. De la matinée, impossible de mettre le pied dehors. Et
naturellement il a fallu renoncer à partir pour Jéricho.
Dans l'après-midi, une espèce de soleil se montre. Nous
sortons. On s'enlise dans une argile collante et nous n'avons pas fait deux
cents mètres que les averses reprennent ; il faut nous réfugier chez un
marchand, l'ami Boulos Meo. Nous en profitons pour acheter quelques
"horreurs". Après quoi nous tentons de poursuivre notre
reconnaissance des lieux saints.
Sous les parapluies nous arrivons à l'église arménienne
ou plutôt à l'église annexée par les Arméniens dans le dépeçage général. Beaux
autels incrustés de nacre et d'écaille. Saint Jacques aurait été décapité là.
En sortant, un prêtre arménien nous asperge d'eau de rose. Il est dit que ce
jour nous serons trempés dehors et dedans.
De là, longeant les casernes turques où les musiciens
s'exercent à jouer des marches militaires avec beaucoup de fifres et de
cymbales, nous allons au Cénacle qui renferme aussi le tombeau de David. C'est
extraordinaire comme tout se trouve réuni dans ce Jérusalem. Ceci appartient
aux Musulmans. C'est une vague mosquée dans laquelle on entre sans chaussures.
Ça n'a rien de remarquable. Il y a un bout de pilier brisé sur lequel Jésus se
serait assis lors de la Cène. Il devait y être bien mal. Mais aussi il se peut
que ça se soit passé ailleurs.
Un peu plus loin, c'est la maison de Caïphe qu'on nous
présente avec l'endroit où Jésus aurait attendu d'être conduit chez Pilate. Ce
lieu est à des Grecs de je ne sais quelle sorte. Ah, j'allais oublier
l'important : dans la cour, la place où le coq a chanté trois fois. Je
contemple avec attention ; le cocorico historique n'a laissé aucune trace.
C'est étonnant.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs
par-dessus la tête de patauger dans cette boue et de recevoir les averses pour
pèleriner à des lieux où il se pourrait qu'il se fut passé quelque chose.
A l'hôtel, trouvé notre consul général. Gueyrault me
conte que les affaires grecques et arabes ne vont pas. La foule s'exaspère
contre les Grecs. Je lui dis mon impression rapportée du saint sépulcre, mon
écœurement des momeries grecques autour du tombeau du Seigneur, et il me
représente que c'est bien plus fort que je ne le suppose. Que ce jour même où
nous sommes, il se produit généralement une cérémonie de carnaval qui dépasse
toute mesure. Cette année, pour la première fois, elle ne se renouvellera pas.
Pour marquer le premier jour de leur carême, les Grecs ornent outrageusement le
saint sépulcre de lanternes, de draperies, d'or, d'argent, d'oripeaux de toutes
sortes, après quoi, se déguisant jusque dans des costumes de femmes, ils se
livrent à une singulière procession qui dégénère en une sarabande, en un
véritable chahut de bal masqué. Les malheureux pèlerins russes qui accourent à
tous les bruits, à toutes les cérémonies, qui se portent partout et lèchent
tout ce qu'ils voient, prennent encore cette débauche des prêtres grecs pour un
édifiant délire et Gueyrault m'assure que dans leur simplicité, les pèlerines
russes ont été parfois entraînées dans les petits recoins obscurs qui ne manquent
pas dans cette rotonde pleine de piliers et que là elles ont vu descendre sur
elles des colombes qui n'avaient rien de mystiques, pour des incarnations sans
aucun miracle. Le supérieur des Franciscains de Bethléem m'a confirmé le fait.
Oh, saints lieux ! Oh, doux Jésus qui chassiez les vendeurs du temple, que
devez-vous dire là-haut !
Jeudi, 25 février
Le soleil luit. En route pour Jéricho. Une victoria
usagée, attelée de trois chevaux de front, nous emporte. Nous contournons la
muraille est ; nous dépassons la porte de Jaffa. Une dégringolade abominable
sur une route obstruée de rochers. On a des inclinaisons parfois angoissantes.
Comment une voiture peut-elle résister à de tels cahots. Oh, triomphe de la
fabrication française ! Au bas de cette chute, c'est la vallée de Josaphat.
J'engage vivement à retenir ses places. Il n'y en aura jamais pour tout le
monde et les Juifs en ont déjà pris la plupart. Enfin il paraît que ça
s'élargira. A notre gauche, le Mont des Oliviers ; à droite le Moriah avec le
temple ou plutôt la mosquée d'Omar sur l'emplacement du temple de Salomon.
On regrimpe. Quelle route ! Mais au haut quelle vue !
Jérusalem, perchée sur ses trois collines avec les ravins énormes qui
l'enserrent. C'est pierreux, rocheux, blanchâtre, avec une mince végétation
entre les rochers, quelques quinconces d'oliviers grisâtres. Panorama superbe.


Jérusalem :
l’esplanade des mosquées sur le Mont du Temple

Bédouin de
l’escorte
Béthanie. Ici une escorte de trois Bédouins nous attend.
Il n'y en a nullement besoin, parait-il, mais enfin c'est dans la tradition. Il
faut les Bédouins ; c'est un tribut qu'on leur paye. C'est d'ailleurs
décoratif. A partir d'ici, c'est la descente sans répit sur la mer Morte. Mille
deux cents mètres au-dessous de Jérusalem, quatre cents au-dessous de la
Méditerranée. La route trace des lacets, descend dans des gorges rocheuses ;
sur les pentes pierreuses, une herbe espacée est tondue par des nuées de
chèvres et moutons noirs qui, de loin, paraissent des bandes de corbeaux. On
croise des chameaux, des ânes, des Bédouins, à pied, à cheval, à chameau et à
âne. Tout cela porte yatagans et fusils ; parfois c'est l'antique moukala
à long canon forgé et à crosse étroite incrustée d'os. Mais la plupart de ces
armes sont les fusils à baguettes à deux coups et les primitifs Lefaucheux.
Beaucoup aussi de fusils de guerre, même à répétition, de tous les modèles
démodés. C'est la houlette de ces pasteurs. Et quelles têtes ! Quelles
attitudes dans ces vêtements flottants !


Bédouins
sur la route de Jericho


Bédouins
sur la route de Jericho
Pourtant voici une courte montée, au haut de laquelle une
sorte de grec tient un khan, un arrêt pour les chevaux et les piétons.
C'est aussi un poste, sur l'emplacement du Bon Samaritain. Ce Grec vend de
l'eau gazeuse, des chapelets, toute une ferraille de couteaux, poignards et
vieux tromblons, actuellement remplacés par les armes ci-dessus décrites.
Après l'auberge du Bon Samaritain, on redégringole et
ferme. La gorge est plus étroite et, dans le fond, à un certain endroit, un
couvent grec est comme encastré dans la muraille de rochers. C'est très beau.
Enfin, à un tournant, une échappée sur la vallée du
Jourdain. En face, la chaîne du Moab s'estompe dans une brume qui est ordinaire
paraît-il, et à droite une surface brillante comme du métal au soleil ; c'est
la mer Morte.
La route est encore plus atroce en approchant de
Jéricho et d'une raideur inconcevable pour une voiture. On passe un torrent sur
des galets énormes.
Jéricho est vite traversée. C'est une bourgade sans
importance ; deux ou trois cents indigènes cultivant quelques jardins où tout
doit pousser seul. Nous continuons encore quelques kilomètres pour arriver à la
fontaine d'Elisée qu'un miracle a rendue potable. On aurait pu éviter ce trajet
aux chevaux. A noter pourtant que ce serait là l'emplacement de Jéricho. Des
Allemands y pratiquent des fouilles qui n'ont pas amené la découverte des
trompettes ni même celle des murailles.
Nous revenons sur nos pas et nous déjeunons à l'hôtel
Bellevue, anglais, tenu par un propriétaire de Palestine. C'est encore possible
comme confortable. Nos admirables petits chevaux ont fait une cinquantaine de
kilomètres qui en valent bien quatre-vingts !
Eh bien, une heure plus tard on les attelle encore et en
route pour le Jourdain. Douze kilomètres sur un terrain qui n'est guère plat
dans une plaine qui pourtant est plate.
Où est la légendaire fécondité de la terre promise ?
C'est indubitablement l'ancien lit de la mer Morte. Une poussière de sel affleure
et par place on croirait qu'il a neigé. Cette terre salée fait une boue qui
tient comme colle forte. Par endroits cependant, une courte végétation
apparaît ; des îlots dessalés par le lavage des pluies, sans doute. Un
couvent grec est installé dans une de ces oasis. Beau lieu pour la méditation.


Mme
François au bord du Jourdain
Bédouin de l’escorte
Enfin voici une ligne de roseaux et de saules. Ils sont
beaux, les roseaux du Jourdain, forts comme des bambous. Taillons nous une trique
dans une de ces branches de saule auxquelles les Hébreux suspendirent leur
lyre. Eh bien, le Jourdain ressemble à une honnête rivière de sous-préfecture ;
un bon petit cours d'eau pour pêcheurs à la ligne. Recueillons pieusement une
eau très sale (St Jean choisissait bien mal son eau lustrale) dans un flacon
décoré d'une croix. Photographions un Bédouin, et en route pour la mer Morte.
Les pluies dernières qui ont détrempé la boue de sel ont
fait des marécages inabordables. Un détour encore pour les malheureux chevaux,
sur des dunes tellement escarpées qu'il faut quitter la voiture - et Dieu sait
si on la quitte difficilement dans ce pays.
Enfin nous sommes sur une grève sans coquillages, devant
une étendue d'eau grisâtre, peu large et qui se prolonge dans une brume intense
(spécialité de la mer Morte) entre des hauteurs escarpées, rocheuses et sans
une végétation. Un tout petit flot bat la rive ; tout le reste est mort.
Montagnes de pierres, plaine de dunes désertiques, pas un oiseau, pas un bruit.
Payons nous toutes les joies ; goûtons l'eau. Brrr ! C'est de l'Hunaydi Janos,
amère, salée, horrible et qui colle aux doigts. Cherchons des cailloux : du
silex et des pierres noires, légères qui, en les chauffant, dégagent une odeur
forte ; c'est la "pierre puante", le bitume dont la mer Morte est
pavée.
Ici encore, nous retrouvons l'écho des affaires grecques.
Notre voiture croise une autre victoria chargée de nobles indigènes se rendant
à Jérusalem. L'un d'eux interviewe notre drogman de qui il apprend les meurtres
commis par le prêtre Germanos. Il s'informe du nom des victimes. Elles sont de
sa famille ! Il saute à bas de sa voiture, bondit sur la nôtre, et, perché sur
le siège, il rentre avec nous à Jéricho pour prévenir sa mère. On sent que
c'est là une affaire qui agite tout le pays.
Vendredi, 26 février
En route de bonne heure pour rentrer à Jérusalem. Nous
mettons souvent pied à terre pour grimper les parties de la route sur
lesquelles nos trois malheureux chevaux ont peine à hisser la voiture vide.
Remarquons en passant que ces bêtes ont fait hier plus de quatre-vingt dix
kilomètres, sur des chemins où on n'aurait même pas eu l'idée, dans nos pays,
qu'une voiture pouvait passer. Enfin, aujourd'hui ils n'en feront guère que
cinquante, mais en s'élevant de mille deux cents mètres.
Le temps est admirable ; une limpidité d'air comme nous
n'en avons pas eu en Egypte et une température idéale. Nous mettons six heures
à refaire la route et nous avons tout le loisir de contempler le pays. Il y a
des échappées de vue sur la mer Morte et sur les monts de Moab, des jeux de
lumière sur toute la pierraille blanche de ces montagnes qui sont de toute
beauté. Et puis les chameaux qui passent en file, liés ensemble de la tête des
uns à la queue des autres, s'avançant d'un pas majestueux qu'un petit bourricot
s'efforce de rendre plus rapide en menant le train et tirant le premier de la
bande. Les Bédouins drapés dans leurs gandouras rayées, la tête enfouie sous
leurs voiles, les moutons et les chèvres aux longues oreilles tombantes,
broutant et cabriolant sur les pentes, tous ces détails ajoutent un pittoresque
extrême à des formes et des couleurs de terrain qui ne sont déjà guère
familières. En bordure de la route, des tapis de petits coquelicots, des
anémones rouges à faire envie à bien des jardins, quelques cyclamens, et, parmi
les rochers, de grandes touffes d'asphodèles. En examinant mieux ce terrain sur
lequel on ne voit que pierres, on découvre qu'avec un peu de soin, avec quelque
main-d'œuvre, des retenues d'eau, il y aurait, parmi les pierres, une terre
extrêmement généreuse qui ne demande qu'à produire. De-ci, de-là, le blé pousse
entre les cailloux qui ne laissent même pas voir le sol. Et mon drogman
m'explique que, pour échapper au fisc, les paysans, loin de débarrasser les
cultures de cette pierraille qui peu à peu disparaîtrait, les en recouvrent au
contraire, afin de faire classer leurs terres au plus bas des appréciations. Un
champ qui vaudrait quarante livres en réalité, serait taxé à quatre-vingts par
les agents turcs et, moyennant les pierres d'une part et le bakchich de
l'autre, on arrive à ne payer que pour vingt-cinq livres.
Beaucoup de ces montagnes pourraient être boisées, mais
pas par l'administration turque ; et aussi rien ne résisterait à la dent des chèvres
que les Bédouins nomades mènent partout tondre l'herbe qui pousse après chaque
pluie. On rencontre sur la route des restes de travaux d'adduction. On trouve
les traces d'un aqueduc qui conduisait l'eau du Jourdain à une altitude
surprenante. Tout ce pays a été évidemment un jardin, artificiel il est vrai,
mais qui pourrait renaître. Le Jourdain canalisé donnerait une force
industrielle formidable par la hauteur de chute qu'on pourrait atteindre. La
même eau arrosant la vallée amènerait une fertilité prodigieuse dans cette
fosse profonde protégée et chaude, assez pour produire la végétation tropicale.
Et la mer Morte elle-même est un réservoir étonnant de produits chimiques. Tout
serait à entreprendre ; ce serait le moment. Nos agents le signalent mais personne
n'entend et quelque jour un syndicat allemand rétablira la Terre Promise
désertée des Juifs.
Les Juifs, c'est à eux que nous en avons, ce vendredi.
C'est pour eux que nous pressons notre rentrée à Jérusalem, afin de ne pas
manquer la cérémonie traditionnelle qui les amène chaque veille de sabbat au
pied de la muraille qui supportait leur ancien temple détruit que remplace
aujourd'hui l'orgueilleuse mosquée d'Omar.
A peine époussetés, nous repartons par les ruelles de
Jérusalem ; nous traversons des quartiers sordides et nous finissons par
déboucher dans une sorte de cour, plutôt un couloir terminé en cul-de-sac, tout
en bas du Moriah. Nous sommes sur la face orientale de la muraille du temple de
Salomon, là où demeurent encore les fondations du temple primitif, surmontées
des murs qui se sont succédés et qui actuellement soutiennent l'esplanade de la
mosquée bleue.

Jérusalem : Juifs en prière au mur du
Temple
Dans cette sorte de fosse, chaque vendredi soir, dès que
commence le sabbat, les Juifs arrivent vers cinq heures, s'appliquent à ce qui
reste de pierres authentiques de leur temple disparu. C'est, sur une
quarantaine de mètres de longueur et une dizaine de hauteur, un solide
contrefort de blocs réguliers et énormes, comme ceux des pylônes égyptiens et
là, en grande tenue, les descendants de l'ancien peuple saint s'écrasent le
front contre les pierres et débitent leurs lamentations sur l'écroulement
d'Israël.
Eh bien, c'est là qu'il faut venir pour bien voir le
"peuple immonde". Quelles têtes ! Quelles faces crochues ! Quels
yeux, quelles barbes tire-bouchonnantes que rejoignent des boucles longues
descendant le long des oreilles jusqu'au cou et dans lesquelles on devine les
poux. Et quels costumes ! D'abord une espèce de toque pointue en velours
crasseux, entourée d'une bande de fourrure hirsute qui fait comme un bord de
chapeau. Puis une longue lévite, quelque chose comme une robe de chambre,
généralement en velours noir, parfois en peluche de toutes nuances, bleue,
cerise, jaune cuivre. Et c'est sale, luisant de crasse, et cela moule des
échines courbées. Et, chez les riches, c'est encore doublé de renard. On y sent
la vermine, brrr ! que c'en est à se gratter rien qu'à les voir passer.
Après avoir enlacé les pierres de leurs bras étendus, les
avoir baisées, s'être frappé le front, ces Hébreux ouvrent un vieux Talmud
poisseux et nasillent des chants, indifférents aux curieux que chaque vendredi
conduit au "mur des pleurs".
Eh bien, faut-il dire que malgré la crasse, malgré
l'antipathie que dégagent toutes ces faces répugnantes et malsaines de Juifs,
cette scène a sa grandeur et produit une impression profonde. Il n'y a pas à
dire, cet exemple de ténacité, cette garde montée auprès des ruines du
sanctuaire est pour inspirer du respect.
Et par ailleurs, quand ici même, dans ce Jérusalem qui
fut leur capitale, on se rappelle l'orgueil de ces Juifs, leur haine pour ce
qui n'était pas juif, pour ces Gentils que nous sommes, et que l'on voit que
cette race n'a rien oublié, que ceux-ci sont bien les représentants des autres,
entretenus par eux pour former ici le noyau du peuple juif, on comprend encore
mieux l'imbécillité qui nous porte, en Europe, à croire à l'assimilation, à la
naturalisation du Juif dans le pays où il a émigré. Jérusalem donne nettement
cette impression : l'union, la persévérance des Juifs devant le déchirement des
Chrétiens.
En rentrant à l'hôtel, nous trouvons devant sa porte un
rassemblement assez considérable. Trois ou quatre cents Arabes du rite grec,
venus de Jaffa au secours de leurs compatriotes et coreligionnaires de
Jérusalem contre les Grecs, attendent la décision que le vali doit prendre pour
trancher le différend, soit en leur faveur, c'est à dire en rétablissant le
patriarche déposé par le synode grec, soit en soutenant ce dernier. Il semble
que la première solution soit facilitée au vali par la disparition
"providentielle" du nouveau patriarche nommé par le synode. Celui-ci
est en effet décédé subitement trois jours après son élection et ce n'est pas
sans difficulté qu'il a été enterré hier et sans pompes. On voit que nous
nageons dans le drame. Ça tourne mal pour les Grecs. Et, ma foi, on s'en sent
satisfait.
Samedi, 27 février
Nous devons aller ce matin à la mosquée d'Omar. Et le kavass
du Consulat qui doit nous en faire ouvrir la porte me remet un mot de mon
collègue Gueyrault : "Si cela peut vous amuser de voir le représentant de
la République processionner cet après-midi, un gros cierge à la main, en
compagnie du patriarche catholique, soyez à une heure sur le parvis du saint
sépulcre. Vous nous verrez entrer en grand uniforme. Vous verrez ensuite entrer
les Grecs, puis les Arméniens, puis etc., ... Et ensuite nous processionnerons
dans la basilique sous la protection de plusieurs centaines de soldats turcs,
car on craint du barouf."
Ah mais, je pense bien que nous y serons au saint
sépulcre. Tout autour de nous on prédit du grabuge. Le vali n'a donné aucune
réponse, naturellement, ni pris parti pour personne. Les Grecs payent à
Constantinople et y sont soutenus ; les Arabes peuvent ici se soulever et les
soldats turcs les soutenir. Donc abstention du vali sur toute la ligne. Donc
des bruits menaçants courent contre les Grecs et si leurs prêtres paraissent au
saint sépulcre autrement que derrière le patriarche cher aux Arabes, c'est le
massacre prétend-on.
En attendant nous allons au sanctuaire de l'Islam. Dieu,
que c'est beau ! Que c'est superbe cet ensemble ! Cette admirable mosquée
bleue, sa coupole de céramique sur l'immense esplanade où se dressa le temple
de Salomon, le sanctuaire des Juifs, puis une église des Croisés. La vue du
parvis entouré des vieilles constructions dorées par un soleil splendide et les
collines de l'est, le mont des Oliviers, les minarets, les coupoles de
Jérusalem à l'ouest, les vieux cyprès, tout cela encadré dans les arches
ogivales d'une série de portiques. Et un ciel, ce jour-là ! Voile-toi, Egypte
brumeuse.

Entrée des
catholiques au saint sépulcre

Soldats
turcs devant le saint sépulcre
A l'intérieur, un jour mystérieux qui vient on ne sait
d'où. Des mosaïques d'un ton admirable garnissent la coupole. Une grille dorée
qui vient des croisés, entoure le rocher sacré, cime du Moriah que recouvre la
mosquée. Il est immense, ce rocher, presque plat et, entouré comme il est, on
dirait un de ces grands plans en relief comme on en présente dans les
expositions universelles. Mais voici les explications données par les imams de
la mosquée et les bêtises commencent.
Ici Abraham a voulu faire le sacrifice d'Isaac. Ici
Mahomet s'est assis ; d'ici Mahomet s'est élancé au ciel. Il a pris un tel élan
que son pied a marqué. Il est d'une forte pointure. Et puis voilà que le rocher
tout entier a voulu le suivre ; c'est à n'en pas douter puisque voilà une
brisure, et il était temps que l'ange Gabriel l'en empêchât, ce qui est tout
aussi certain puisque voici la trace de son doigt, un index de forte taille.
Pour honorer tout cela, on a mis dans une châsse deux
poils de la barbe de Mahomet. Cela fait que j'en connais trois, en ayant déjà
vu un premier à Lahore.
Maintenant passons sous le rocher, car il ne manque pas
d'y avoir une grotte. Cela fait une bouche et comme une bouche ne peut pas être
privée de langue, le rocher en a une. Les Musulmans embrassent cette langue et
pour leur faciliter cette opération, on a mis un pilier.
La grotte n'est pas haute et comme Mahomet ne pouvait s'y
tenir debout, sa tête a fait un trou dans le roc. Je suis à peu près de la même
taille que Mahomet mais je n'essaye pas de la déployer par le même procédé. Ici
Abraham a prié. Salomon a prié. David a prié et je pense qu'Isaac a dû
profondément s'embêter. Avalons une dernière bourde. Voici une pierre, verte.
Mahomet y a enfoncé des clous, on n'a jamais su pourquoi ces clous s'usent et
s'en vont, et quand il n'y en aura plus ce sera la fin du monde. Saperlipopette
! Enfin il paraît en rester encore pour un bout de temps. L'imam me prévient
qu'en faisant une aumône pour l'entretien de ces clous, qu'on recouvre
d'ailleurs d'un tapis, on gagne le ciel. Allons-y ; montons au ciel. Pour un shilling
c'est pour rien. Mais l'imam me fait remarquer qu'il faudrait peut-être assurer
aussi le ciel à ma femme. Comment donc, je ne veux pas qu'on nous sépare. Ça ne
coûte qu'un shilling de plus. L'imam est très content de moi. Nous nous
quittons en nous souhaitant de nous revoir chez Mahomet et "soigne bien
tes clous, bon imam". Et il rit.
A présent il est temps d'aller rapidement déjeuner pour
être prêt à nous faire tuer sur les marches du saint sépulcre, car tout le
monde nous prévient que ça va chauffer ferme. Heureusement que je viens
d'acquérir le paradis pour deux francs cinquante à la mosquée d'Omar. Et nous
partons pleins d'assurance.
Après un rapide déjeuner, nous nous dirigeons vers le
saint sépulcre. Les voyageurs de l'hôtel nous regardent partir comme des
imprudents qui marchent à un trépas assuré. Les racontars de leurs drogmans les
ont effrayés à tel point qu'aucun n'ose se risquer. C'est cependant une des
cérémonies les plus intéressantes de l'année, cette cérémonie du premier samedi
de Carême à Jérusalem.
Quand nous arrivons au parvis du saint sépulcre après
avoir parcouru les voies d'accès passablement agitées, nous trouvons l'espèce
de terrasse qui fait face au portail occupée par les Arabes chrétiens venus de
Jaffa pour faire un mauvais parti aux Grecs. Nous rencontrons quatre pères
dominicains français, curieux eux aussi de voir ce qui pourra advenir. Nous
nous plaçons avec eux dans la masse des Jaffiotes et ils nous disent que,
d'après ce qu'ils entendent des conversations, si les Grecs se risquent
aujourd'hui au saint sépulcre, il y aura bataille car la population chrétienne
indigène est extrêmement montée et paraît résolue à ne laisser passer aucun
prêtre grec si le patriarche déposé n'est pas rétabli.
Un bruit de bottes sur le pavé des ruelles nous annonce
l'arrivée d'une troupe et nous voyons déboucher une compagnie de soldats turcs
qui se forme en bataille à droite du portail. Peu après, une deuxième compagnie
renforce la première et se forme à gauche. Ces pauvres soldats turcs paraissent
avoir mis ce qu'ils ont de meilleur comme uniformes ; leurs vestes n'ont pas de
trous et ils ont tous des bottes. Beaucoup auraient besoin d'un ressemelage et
le drap des vestes est râpé et déteint, mais enfin les hommes sont chaussés et
vêtus. On nous dit que la population de Jérusalem fait de temps à autre des
souscriptions pour acheter des uniformes à ces pauvres diables. Par contre les
armes, d'excellents fusils modernes, sont brillantes, admirablement
entretenues. La troupe a l'air solide et sait manœuvrer.
Peu après, des coups de canne retentissent, frappés sur
le pavé, et voici le cortège du patriarche catholique. Ça n'est pas très
imposant. Les quatre kavass du Consulat, revêtus d'un superbe uniforme bleu de
ciel tout doré, costume des Albanais ordinaire aux kavass des consuls de tout l'Orient, ouvrent la marche, yatagan en
sautoir, la ceinture pleine de coutelas et de pistolets à montures d'argent.
Ils ont en outre une longue canne de suisse à pommeau d'argent. Derrière eux,
côte à côte, le consul général de la République, en grande tenue, et le
patriarche catholique qui n'est encore qu'en grande tenue de ville, manteau
violet et chapeau. Derrière, le chancelier du Consulat, aussi en uniforme et
deux haut-de-forme qui jurent singulièrement parmi les fez et turbans. Derrière
eux, la cohorte nombreuse des Franciscains.

L’escorte du consul de France en tête de la
procession
Le cortège s'engouffre dans le saint sépulcre et ce doit
être le tour des Grecs puis des Arméniens, des Coptes, etc., car aucune
cérémonie ne peut commencer dans le saint sépulcre avant que tous les rites y
aient pris leurs positions respectives.
Les Grecs viendront-ils ; y aura-t-il bataille ? C'est
alors ce que chacun attend. Mais, après un temps assez long, on annonce que les
Grecs sont terrés dans leurs couvents, gardés par des soldats turcs et n'osent
mettre le nez dehors. Nous entrons donc dans la basilique pour y voir pénétrer
les Arméniens, tandis que dans la chapelle des Franciscains, le patriarche
catholique revêt ses ornements. Tout autour du saint sépulcre et dans tous les
détours, carrefours et recoins de la basilique, le spectacle est étrange et
théâtral. La chapelle grecque qui fait face au saint sépulcre est fermée mais
des lampes, des ornement d'or et d'argent, des étoffes sont partout pendant.
Une foule de moujiks russes encombre cette entrée et dans deux balcons qui la
flanquent comme deux avant-scènes, des femmes russes sont pressées à étouffer
faisant un singulier contraste de misère parmi le clinquant de la décoration
grecque. Et tous ces hommes à grandes bottes, la tête rejetée en arrière,
encadrée de crinières blondes, les yeux en extase, lancent sans discontinuer de
larges signes de croix, se balancent d'avant en arrière, se jettent à terre
baisant les pierres.
Au pied des colonnes, des mendiants accroupis réclament
au nom de Jésus, musulmans très probablement. Des Bédouins à burnous et
porteurs de matraques, regardent curieusement une foule bigarrée circulant en
tous sens comme sur une place publique. Il n'y a pas d'autre mot pour
caractériser le lieu. Des soldats turcs, immobiles sous les armes, sont
disséminés en faction dans tous les coins et leurs officiers, tendant le
jarret, traînent leur sabre sur les dalles comme sur une place d'exercice
pendant un repos de manœuvres. Des curés en voyage promènent là leur soutane
comme de simples curieux, des Pères blancs ou Dominicains également sont là
comme dans la rue et c'est encore un mélange extraordinaire de vêtements
sacerdotaux, d'emblèmes de tous les cultes chrétiens connus.
Dans un coin, les Arméniens préparent leur cortège. En
tête, deux figurants coiffés d'une tiare comme Charlemagne, dans de magnifiques
robes de soie rouge damassées de jaune avec des cannes crosses, des croix dans
des cercles d'or. Puis des prêtres à bonnets pointus en soie noire, se
terminant en voiles tombant sur de mêmes robes rouges à dessins jaunes. Des
cierges, des emblèmes et enfin le patriarche arménien, une admirable tête à
grande barbe blanche, enfouie dans la soie noire du bonnet et du voile, marche
péniblement dans un grand manteau tout en or, bénissant d'une grande croix d'or
et de pierreries, tandis que des officiants tout en noir aspergent l'assistance
d'eau de rose lancée de flacons d'argent. Ce cortège étrange s'ébranle au
milieu d'une profusion de cierges, d'encensoirs balancés et des chants
inharmonieux éclatent, accompagnés d'un assourdissement sauvage produit par des
plaques de métal frappées à tour de bras dans la partie des galeries
supérieures réservées aux Arméniens. Cette procession se déroule autour du
saint sépulcre, entre les soldats turcs, bardés de cartouches, l'arme au pied,
impassibles. Et les Russes se signent plus fort, ondulent plus bas et baisent
les pierres tandis que leurs femmes gloussent ou sanglotent dans les
avant-scènes.
Derrière les Arméniens, voici les Coptes, sans habits
sacerdotaux, un long manteau noir, comme un burnous, une calotte rouge, un
turban noir. Ils passent seulement en nasillant, sans emblèmes et gagnent leur
chapelle perchée dans les galeries. Derrière les Coptes, les Syriaques. Cinq ou
six représentants seulement, dont un en robe rouge et tiare comme les
Arméniens, va s'abriter dans la chapelle accrochée comme une niche au saint
sépulcre même et qui ne peut contenir qu'une personne.
Les Maronites, deux ou trois se placent derrière les
Syriaques, auprès d'un simple pupitre, comme les Abyssins nègres dans leur
costume noir surmonté d'une haute toque noire.
L'entrée des cortèges est terminée. C'est aux Catholiques
à officier.
Du fond de la basilique, de la chapelle dite de la
Couronne d'épines, leur procession descend lentement, précédée de la croix
latine aux mains d'un Franciscain. Le patriarche suit, en longue traîne
violette et en manteau d'hermine. Le consul général de France en uniforme,
portant un lourd cierge, entouré de ses kavass
dont un transporte un coussin pour les multiples stations à genoux de son chef,
le personnel du Consulat portant des cierges et nous qui suivons entre la haie
des Franciscains en capuchons bruns, chantant des cantiques.
Lentement, lentement, la procession parcourt la
basilique, s'arrête à tous les emplacements traditionnels, descend dans les
cryptes et Gueyrault reposant son cierge à terre, s'agenouille à toutes les
stations du chemin de la Croix. On contourne la chapelle grecque, on monte au
calvaire, on redescend et trois fois, d'une marche plus lente encore, la
procession contourne le saint sépulcre. Sur cette espèce de place, dans la
cohue des costumes, des races, des rites, cette marche est saisissante. Il y a
une impression difficile à rendre, tant de sujets se présentant à l'esprit. Ce
lieu où se déchirent les Chrétiens jusqu'au meurtre, cette exploitation
mercantile d'autre part par les Grecs et d'autres industriels, cette foule de
curieux, ces Blancs, ces Bédouins, ces Nègres, ces Juifs au nez caractéristique
et costume des tableaux de Rembrandt ; cette cohue des cultes qui
s'observent, ces costumes, ces ornements ; ces Russes qui donnent la note
émouvante de bonnes gens apportant une foi qui s'aveugle devant tout le reste,
tout ce qui jure à nos yeux, et qui accourent partout où l'on chante, où l'on
officie et qui se signent sans cesse, qui embrassent tout, qui achètent tout,
jusqu'aux balayures que leur vendent les Grecs avec des passeports - teskérés
- pour le ciel. Il faut cette manifestation naïve de ces pauvres Russes pour
ramener au véritable sentiment qu'il faut éprouver en ces lieux. Et c'est
encore un autre sujet saisissant que vous procure la vue de ces soldats turcs,
de ces Musulmans étalant leurs sabres et leurs cartouches pour maintenir
l'ordre dans ce berceau de la Chrétienté.
Nous sortons de là vivement remués. Quelle étrange ville
que cette Jérusalem ! Lieu saint des Juifs ; lieu saint des Chrétiens, lieu
saint des Musulmans. Ceux-ci pleurant leur gloire et se serrant autour de leur
muraille, ceux-là qui devraient être ici unis et triomphants autour de la
sépulture de leur Sauveur et qui ne s'y maintiennent que sous la protection
turque !
Dimanche, 28 février

Jérusalem :
Le Mont des Oliviers
En voiture au Mont des Oliviers. On emprunte tout d'abord
la même route que pour Jéricho. On passe devant la colonie juive organisée avec
les fonds des grands Juifs d'Europe, dont les Rothschild, et qui a tout
l'aspect d'une cité ouvrière : trois rangées de bâtiments parallèles et divisés
en cases exactement semblables. Pour une somme mensuelle minime, chaque
"colon" peut devenir propriétaire des deux chambres qui lui sont
allouées, en une dizaine d'années.
A l'extrémité de l'enceinte de la ville, on laisse à
droite la route de Jéricho, à gauche la route de Naplouse et on prend la route
spéciale qui a été faite pour la visite de Guillaume II. Tout d'abord on
rencontre les tombeaux qu'on continue à nommer tombeaux des Rois de Juda,
d'après une indication écrite en français sur un marbre noir, car nous sommes
ici sur un terrain de la France, donné par les Pereire. Mais il paraît que
cette inscription est une honte pour la science car il est avéré que jamais les
rois de Juda n'ont usé de cette sépulture et qu'il s'agit seulement d'une reine
qui eut deux douzaine d'enfants. Quoi qu'il en soit, ces caveaux en forme de
fours creusés dans les parois d'une grotte profonde divisée en chambres sont
extrêmement curieux.
De ces
tombeaux on gagne le sommet le plus élevé des hauteurs qui entourent Jérusalem
et on redescend légèrement pour arriver au Mont des Oliviers proprement dit.
Là, on est chez les Russes qui y ont une église, un couvent de femmes et une
haute tour carrée qui se voit de Jéricho et de la mer Morte. Panorama admirable
vers la vallée du Jourdain et sur Jérusalem. On plonge directement sur le Haram
et aperçoit l'ensemble magnifique de la mosquée d'Omar au milieu de son
esplanade.
L'église est pleine de pèlerins russes et les diaconesses
russes chantent en chœur, amusantes dans leur robe noire, leur guimpe noire
(comme celle des Sœurs des Pauvres), surmontée d'une toque plate. A quelques
pas au-dessous, le lieu de l'Ascension. Ceci est aux Musulmans qui y ont placé
un petit monument à coupole. De même que Mahomet, Jésus aurait donné un fort
coup de pied pour s'élever et le roc en porte l'empreinte. Mahomet avait le
pied moins fin. Les Musulmans reconnaissent le droit aux Catholiques d'y
officier une fois par an.
En descendant encore un peu, on est à l'endroit où
Jésus-Christ enseigna le Pater aux apôtres. La place est ici aux
Carmélites. Un joli petit cloître garni de plaques de marbre avec le Pater
écrit en trente quatre langues, dont le breton, et au centre d'un des côtés, un
mausolée de la Duchesse de la Tour-d'Auvergne.
Au couvent russe, nous apprenons que l'archimandrite qui
le gouvernait a été assassiné quelques jours plus tôt et qu'on soupçonne de ce
crime le même prêtre grec Germanos qui vient de tuer trois indigènes hostiles
aux Grecs.
La voiture que nous avons quittée a trouvé le moyen de
descendre par l'ancien chemin du Mont des Oliviers. Ça c'est un tour de force
qui aurait son succès au cirque. Il y a même une travée d'escaliers pour corser
l'exercice. Nous longeons le cimetière juif dont les tombes occupent le versant
oriental de la vallée de Josaphat. Ces tombes toutes pareilles, une pierre
étroite et basse, le plus souvent sans inscription, sont serrées de façon à
donner l'idée d'un dallage s'étendant sur toute la colline.
Au bas du champ des Juifs, c'est une sorte
d'anfractuosité où les apôtres s'endormirent au lieu de prier, durant la
dernière nuit du Christ. Un enclos attenant à ce lieu ferme ce qui reste de
l'ancien jardin de Gethsémani. Un bon Franciscain, le Frère Julio qui en est le
jardinier nous en fait les honneurs avec une charmante amabilité. "Prenez
toutes les fleurs que vous voudrez, nous dit-il" et il met lui-même ses
plates-bandes au pillage. Il pousse des violettes entre les ruines des
vénérables oliviers contemporains, dit-on, de Jésus et dont l'un a pris le nom
d'olivier de l'agonie ; son tronc qui n'a plus que de l'écorce se
développe sur plus de deux mètres.
En sortant de ce clos, nous sommes assaillis par une
bande de lépreux qui ont monopolisé cette partie des saints Lieux pour y
établir leurs horreurs. Je donne en bloc et ça va très bien ; c'est comme un
syndicat.
Un
tournant plus loin, voici un portique qui sort à moitié de terre, comme une
entrée de cave. La tradition y place le tombeau de la Vierge. Mais la porte est
close. C'est aux Grecs et nous en cherchons vainement le gardien. Des Abyssins
qui y ont une chapelle sont comme nous consignés à la porte. Ils en baisent les
gonds, le bois et tous les clous.
Un grand diable de Russe qui passe sur la route enlève
son bonnet de peau de mouton. Hélène croit devoir lui rendre son salut, mais
c'est à la Vierge qu'il en a. Après s'être signé une quarantaine de fois, et
avoir élevé les bras au ciel, il s'agenouille et se prosternant, ses longs
cheveux blonds s'étalant sur le sol, il embrasse la poussière où piétinent les
lépreux.
Pendant qu'on cherche le gardien grec, nous allons au
bout d'un couloir aboutissant à une grotte, la grotte de l'agonie où Jésus
aurait été saisi. Ici c'est aux Franciscains qui y ont un autel. Le Père qui le
garde nous apprend que, quelques instant auparavant, cinq indigènes de Jaffa
sont venus pour assassiner le prêtre grec, son voisin, qu'heureusement pour ce
dernier, des soldats turcs ont pu intervenir et que le Grec doit être chez des
Musulmans voisins.
Notre drogman trouve l'homme et le ramène avec ses clés.
Nous pénétrons donc dans cette église souterraine très curieuse où, à défaut du
tombeau de la Vierge, on montre celui attribué à Saint Joseph, ainsi que
d'autres affectés à Sainte Anne, Joachim, etc. En pénétrant nous avons fait la
joie des Abyssins qui ont pu nous suivre. L'émotion, la ferveur de ces gens-là
sont vraiment impressionnantes. L'un d'eux, noir comme l'ébène, dans une
tunique blanche, pousse des soupirs profonds, touche avidement l'étoffe de
l'autel, à tous ses plis, la porte à ses lèvres, colle sa bouche longuement à
tous les coins de la pierre, des marches. Il fait trois fois le tour de l'autel
en se courbant et baisant tout d'une façon sonore. Je m'arrête longuement à
contempler cette extraordinaire manifestation ; je le vois enfin s'aplatir
devant l'autel, appliquer sa bouche sur le sol et il y demeure un temps que je
ne puis apprécier puisque, lassé d'attendre, je m'éloigne le laissant dans
cette attitude.
Vraiment, l'émotion de ces pauvres gens est touchante.
Une femme abyssine que nous avions vue plaquée contre la porte n'osant entrer,
est encore là quand nous ressortons. Elle n'a pas bougé. J'ajoute que, tandis
que nous visitons l'intérieur de son église, le prêtre grec est entré en grande
conversation avec notre drogman au sujet de l'incident qui vient de l'émouvoir
violemment. Et dans ce tombeau de la Vierge dont il est le gardien, ce prêtre
échappé assez heureusement au meurtre, ne songe qu'à la haine et c'est en
vociférant qu'il accuse son patriarche de céder aux Arabes et aux Russes une
partie des profits que ses semblables prétendent se réserver. Et il annonce que
si on leur impose ce chef, ils le tueront. Cette scène dans ce lieu donne une
idée des sentiments de ces Chrétiens dits Orthodoxes qui exploitent Jérusalem.
Les lépreux nous assaillent de nouveau mais sur la
représentation qu'ils ont déjà reçu, l'un d'eux dit : "Oui, c'est vrai, et
nous ne demandons plus rien. Qu'ils aient un bon voyage pour rentrer chez
eux".
On est moins discret de l'autre côté de la route où une
file de mendiants profite de ce que l'un de nos chevaux refuse de regrimper la
côte (ce que je comprends, du reste) pour nous assaillir. Il est là-dedans des
femmes jeunes dont l'exploitation de Jésus est un métier très profitable car on
nous dit qu'elles sont riches.
Et c'est maintenant fini. Nous avons posé le pied dans
tous les endroits mémorables de Jérusalem. On gagnerait certes à les revoir et
en choisissant des moments où l'on pourrait s'y mieux recueillir. Mais, je le
répète, ce n'est pas ici qu'il faut attendre ce que l'on n'apporterait pas
d'avance à Jérusalem.
*
* *
Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Béthanie, etc. Voyons, je
voudrais bien résumer mes impressions en une formule. Eh bien, je crois que la
voici : Jérusalem, capitale des schismes et foire des religions. Il n'y a pas à
me dissimuler. C'est cela.
Pardon Madame ou pardon Monsieur, si ces notes vous
tombent sous les yeux et si ma formule vous choque. Veuillez bien ne pas bondir
et crier au sacrilège. Je n'y peux rien si les choses sont ainsi et si les
hommes les ont faites ainsi. Je n'entends tirer de là nulle conséquence qui
puisse attrister aucune conviction. Je ne me livre à aucune attaque. Je suis
sûr qu'à Rome comme en tous lieux on pense que le mieux est de jeter un voile
sur Jérusalem et qu'il n'est pas à souhaiter que les "lieux saints"
soient trop aisément accessibles. Ce ne serait pas un spectacle sain à offrir
aux sentiments superficiels et à ceux qui, attendant d'y recevoir un "coup
de foi" (involontaire calembour, je le jure), s'en reviendraient
démoralisés pour ne pas y avoir rencontré Jésus-Christ. En effet, si
Jésus-Christ est partout, il n'en est pas moins évident que c'est à Jérusalem
qu'il est le moins. Et il est prudent, à mon sens, d'en avertir soigneusement
ceux qui se rendraient ici actuellement avec une âme de croisé. Pour y ramener
le Christ, il faudrait une nouvelle croisade. Il ne peut tenir boutique dans
cette foire.
A mon humble avis, voici : il y avait un tout petit pays,
bien pittoresque, bien miséreux, bien pierreux. Sur une des collines, la plus
haute, la plus escarpée et dans les ravins rocheux qui lui font suite, il s'est
passé des événements immenses qui ont changé la face du monde. Cette nature
grandiosement farouche a vu des temples admirables, celui de Salomon, et le
berceau sanglant du Christianisme. De cela il ne reste rien, mais rien ; pas
même la possibilité de fixer avec une exactitude même approchée les
emplacements témoins des événements. Un seul vestige, un seul, marque un
souvenir matériel précis, comme les monuments d'Egypte, c'est un pan de mur de
la terrasse de Salomon. Voilà qui fixe les Juifs, mais assez peu encore pour
qu'ils aient été portés à ne jamais franchir l'enceinte de ce mur afin de ne
point risquer de profaner l'emplacement du tabernacle que nul Juif ne doit
fouler et qu'ils ne sauraient préciser.
Pour tout ce qui touche au Christ, à sa passion, il n'est
même pas possible de retrouver la plus petite trace matérielle. Tout se passe
sur les rochers, dans des grottes, qui ici étaient innombrables, et dans de
misérables chaumières. On ne sait même plus déterminer ce qui était dans ou
hors les murailles de la ville ; les fondations même de ces murs ne se
retrouvent pas. C'est alors que pour nous remettre avec Jésus-Christ sur son
Calvaire dans son tombeau, pour offrir aux fidèles des lieux où s'agenouiller,
des pierres à baiser, on a eu recours à de simples suppositions dont certaines
sont invraisemblables, d'autres sûrement erronées et les autres toujours
contestables. Et, au lieu de laisser à l'ensemble de ces lieux leur grandeur
mystérieuse qui eut été impressionnante, les différents cultes, avec une
rivalité de mercantis, pour ne pas dire pis, ont dressé des édifices,
déplorables de goût surtout, qui choquent les yeux et ils offrent à la
vénération des Chrétiens jusqu'aux rocher dont Jésus se serait aidé pour monter
sur son âne en un point quelconque de ces vastes solitudes pierreuses. Et on a
doré ces cailloux, on a tout couvert d'un clinquant horrible, sans qu'une seule
manifestation d'art puisse servir d'excuse.
Et des prêtres de toutes couleurs, des grecs surtout et
des popes avec des faces de marchands de lorgnettes et des déguisements
grotesques, braillant comme des aveugles, encensant du matin au soir, sont
embusqués sur chaque roche, dans chaque grotte, comme araignées au coin de
leurs toiles, tenant boutique et luttant contre la concurrence même avec le
couteau et le fusil. Voilà ce que, dans une simple visite de Jérusalem, il est
impossible de ne pas voir, ce qui blesse les yeux, assourdit les oreilles,
excite l'indignation et chasse le recueillement. Voilà aussi ce dont profitent,
dans une certaine mesure, les Juifs unis devant leur mur des pleurs laissé
respectable et les Musulmans dignes autour de leur mosquée.
Non, Jérusalem n'est impressionnante en l'état actuel que
pour les braves moujiks et les Abyssins si touchants dans leur foi et assez
grossiers pour ne pas apercevoir ces horreurs. Pour la rendre au recueillement
nécessaire, il faudrait un nouveau miracle ; l'Esprit Saint devrait descendre
en langues de feu sur tous ces oripeaux et aussi en lanières de cuir sur les
épaules de toutes les racailles qui se disent orthodoxes. Ainsi soit-il.
Auguste
François