Les fêtes de l’alliance franco-russe - Paris et Toulon, 1893.
Depuis
la Révolution de 1789 et l'expédition de Napoléon Ier à Moscou, les rapports
franco-russes étaient difficiles. Le Congrès de Vienne de 1815 avait isolé la
France. En Orient, où la Russie pour justifier ses ambitions revendiquait le
protectorat sur tous les orthodoxes de l'Empire ottoman, les deux pays
s'opposaient constamment. Redoutant qu'un conflit russo-turc en Roumanie ne
tourne à l'écrasement de la Turquie, Napoléon III et l'Angleterre avaient
organisé l'expédition de Crimée pour freiner l'expansion russe vers les
Balkans, la mer Noire et Constantinople. La Russie avait dû se retirer des
principautés roumaines, accepter la neutralisation de la mer Noire et l'internationalisation
du Danube. Les tentatives de rapprochement avec la Russie entreprises ensuite
par Morny furent contrariées par le soutien que Napoléon III accorda aux
mouvements nationalistes roumains et surtout polonais. Depuis que la Pologne
avait été partagée entre l’Autriche, la Russie et la Prusse, cette dernière
s'étendait jusqu'en Lituanie, voisinant donc directement avec l'empire des
tsars que Bismarck avait réussi à mettre dans son jeu. Lors de la défaite
française de 1870, la Russie refusa sa médiation à la France. Avec le
consentement de Bismarck, elle profita même de l'occasion pour dénoncer le
traité de 1856 et reconstituer une flotte en mer Noire. Le régime autocratique
des tsars avait ensuite vu d'un mauvais œil la république s'instaurer en France.
Mais la Russie à l'économie archaïque poursuivait son expansion au sud et à
l'est et avait d'énormes besoins financiers. Devant le refus de Bismarck de lui
accorder le prêt qu'il sollicitait, Alexandre III (1881-1894) fit appel, à
partir de 1888, aux capitaux étrangers. La France s'empressa de proposer ses
services que le tsar accepta d'abord avec réticence. On s'efforça alors de
prolonger cette aide financière par des accords militaires et politiques avec
la Russie. En 1891, l'amiral Gervais conduisant une flotte française à
Cronstadt avait été reçu à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Une alliance
franco-russe prenant l'Allemagne en tenaille permettrait, espérait-on, à la
France de venger l'humiliation de 1870.
C'est
dans ce contexte que se situe la réception en France, que devait bientôt suivre
celle du Tsar, d'une délégation d'officiers russes conduite par l'amiral
Avelane que retrace ci-dessous Auguste François[1].
Quelques
épithètes polémiques à relent raciste, assez contestables pour le lecteur
d'aujourd'hui, reflètent l'atmosphère qui régnait en France à l'époque,
Les fêtes de l'alliance franco-russe en 1893
Bourquenay, directeur du Protocole depuis quelques
semaines seulement, ayant jugé à propos de se déclarer indisponible, par suite
d'une attaque subite de goutte plutôt diplomatique, Develle, mon patron, me fit
prendre, pour la circonstance, le poste à Paris - tandis que Mollard,
sous-directeur, fonctionnait à Toulon - pour préparer ici la réception de
l'amiral Avelane et de ses officiers.
Nous ne savions où donner de la tête pour mettre debout
un programme pouvant concilier les propositions de trop de bonnes volontés.
Au plan purement protocolaire du Gouvernement, il fallait
joindre les prétentions de la Presse et de presque tous les corps constitués qui
réclamaient impérieusement une participation particulière aux fêtes, avec des
réceptions personnelles, comme la Municipalité de Paris, l'Académie, les
Chambres de Commerce, tous les groupements artistiques, industriels, etc. Un
trimestre n'eut pas suffi à épuiser des réjouissances et des manifestations
d'enthousiasme souvent comiques ou saugrenues et sans souci de la plus
élémentaire dignité nationale.

Le ministère des Affaires étrangères
J'avais à discuter avec des gens excessivement échauffés,
persuadés de l'importance de leurs élucubrations et surtout de l'élévation de
l'éloquence qu'ils s'apprêtaient à déverser à flots. C'est sur ce dernier point
surtout que j'avais à supporter les récriminations les plus aigres. Si, à la
rigueur, je pouvais faire admettre la suppression de visites et de promenades
aux quatre coins de Paris et de la banlieue, il était impossible de faire
renoncer à des discours qui devaient accompagner des remises de livres d'or,
des adresses, des cadeaux de toutes sortes même les plus imprévus, allant de la
bijouterie à l'épicerie, du liquide au solide, de l'ameublement à
l'habillement. Toutes, absolument toutes les productions de l'art, de
l'industrie et de l'agriculture y étaient représentées ; elles affluaient déjà
au Quai d'Orsay de tous les points de France. Nous en étions submergés : des
vins par barriques, ou centaines de caisses, de la confiserie sous toutes ses
espèces, de la vaisselle, des services de table au chiffre de chacun des
bateaux russes, des meubles, des bronzes, toutes les spécialités, même des plus
petites maisons de province, affluaient. Il y eut le chargement d'un cargo au
départ de l'escadre.
C'est naturellement la Presse qui nous apportait les plus
vives difficultés. Elle prétendait tout accaparer, sous la présidence d'Arthur
Meyer[2],
lui-même débordé par les représentants de tous les canards de Paris et de
Province.
Deux de mes plus désagréables conflits se produisirent
d'une part avec le marquis de Vogüé et de l'autre avec Maizières de l'Académie
française qui tous deux avaient composé des harangues empiétant fâcheusement
sur le domaine diplomatique et même de la politique internationale. L'autorité
du Protocole se montrant insuffisante vis à vis d'illustrations comme le
marquis de Vogüé, ex-ambassadeur, qui n'admettait pas que le ministre des
Affaires étrangères lui-même put solliciter la communication de son discours et
encore moins de formuler la moindre critique, il fallut l'intervention du
président du Conseil. Et c'est à moi, moucheron interposé entre ces enclumes et
marteaux, qu'il incombait d'obtenir le retranchement d'un mot ou la
substitution d'une phrase un peu moins platement laudative insérée dans des
périodes dithyrambiques élaborées en séances académiques. Ceci me procurait des
colloques répétés et sans affabilité.
Quand tout paraît conclu, que la Presse a accepté de ne
pas figurer plus d'une ou deux fois dans chaque journée, il reste à faire
agréer le programme par l'ambassadeur de Russie et, là encore, je devais me
prendre aux cheveux avec le sympathique baron de Morhenheim.
Ce vieux juif, d'origine allemande, sourdement hostile à
l'alliance et dont il fallait neutraliser l'influence, avait, on ne sait
pourquoi, l'oreille du Tzar. Il se sentait tenu ici à l'écart des négociations
et voyait de fort mauvais œil venir cette ambassade extraordinaire de l'amiral
Avelane qui allait, un moment, l'éclipser. Il mettait toutes sortes de bâtons
dans les roues, pour restreindre le rôle de l'Amiral, criant qu'on voulait tuer
ses marins, en quoi il n'eut pas eu complètement tort, s'il se fut un instant
soucié de leur santé.
Enfin, le 11 octobre[3],
par un matin brumeux, j'attendais sur le quai de la gare du P.L.M. l'arrivée du
train spécial qui nous amenait nos hôtes. Nous en voyons descendre deux
douzaines d'officiers, la plupart barbus assez hirsutes, dans des uniformes
ternes, sans grand prestige, et qui, très froids, sans la moindre effusion, se
laissent conduire aux landaus dans lesquels nous les répartissons, accompagnés,
dans chacune des voitures, d'un représentant de la Marine de Guerre et des
Affaires étrangères.

Arrivée de la délégation russe au Quai
d’Orsay
Hors de la gare comme sur tout le parcours jusqu'à la
place de l'Opéra et au Cercle militaire, les chaussées sont bondées d'une foule
qu'on sent émue et vibrante mais qui n'ose encore laisser éclater ses
sentiments, soucieuse très visiblement de garder de la dignité dans ses
manifestations ; tout le monde, comme par un mot d'ordre, s'impose une retenue
qui me fait plaisir.
Les
façades des maisons disparaissent sous les drapeaux unis de France et de
Russie. Aux fenêtres, comme dans le fourmillement de la rue, les têtes qui se
découvrent montrent suffisamment ces sentiments contenus. Cet accueil de bon
ton se continue aussi bien dans les quartiers populaires que tout au long des
rues opulentes et des Boulevards. Dans mon landau d'arrière-garde, en compagnie
de mes trois Russes qui ne démusellent pas, ne laissent rien transparaître,
d'aspect presque rébarbatif, je note avec grande satisfaction cette tenue de la
foule, cette attitude de bonne compagnie dont la gracieuseté s'accroît à mesure
qu'on pénètre dans le centre. Quel heureux contraste avec ce que nous devions
expérimenter les jours suivants, les hurlements frénétiques et même les scènes
d'hystérie qui ne parvenaient pas davantage à dégeler ces hommes du Nord.
Au Cercle militaire qui leur est entièrement affecté, où
des appartements leur ont été confortablement aménagés, où des tables sont en
permanence couvertes de mets et de boissons, nos hôtes retrouvent leurs
samovars fumants tout au long des journées et des nuits, voisinant avec nos
meilleurs crus de France et accompagnés, à profusion, des produits les plus
truffés envoyés par les plus renommés de nos restaurants, des viandes fumées,
du caviar, etc. A côté de cela s'amoncellent des montagnes de boîtes de
douceurs, de bonbons, de confiseries de toutes sortes, des produits de
parfumerie, jusqu'à des objets de toilette et même de lingerie qu'on ne sait
plus où fourrer. Eh bien, ces officiers, ambassadeurs d'alliance, vont
impassibles, nullement touchés de telles attentions ; ils demeurent bouclés,
sans contact avec nos officiers de terre et de mer, nos attachés dont
l'empressement finit par se figer aussi. Nous demeurons entre Français, à côté
des Russes.
Le lendemain, visite de l'amiral et de ses officiers au
président de la République. Même foule. Jusqu'à l'Elysée, c'est un entassement
dans lequel les voitures ont peine à s'insinuer malgré la troupe qui est
submergée. Les gens sont maintenant échauffés, les acclamations éclatent
formidables, en tonnerre. Eux, toujours aussi placides et froids.
A l'Elysée, présentation au président Carnot. Toute la
banalité ordinaire de ce genre de cérémonie.
J'accompagne mon ministre, Develle, qui a une mine
renfrognée. Au retour, tandis que sa victoria se fraye lentement son chemin
dans le faubourg Saint-Honoré, mon uniforme désigne à la foule le ministre des
Affaires étrangères. C'est aussitôt une tempête de vivats associant le nom de
Develle à celui du Tzar. Develle ne répond pas. Pas un geste. Il bougonne dans
le coin de sa voiture. Je le presse de saluer, de remercier un peu des ovations
qui lui sont personnelles. Je suis mal reçu ; puis, soudain il se dresse et, à
ma stupéfaction, la mine irritée, il vocifère au milieu des milliers de cris
"Vive l'Alliance", "Vive la Russie", "Vive
Develle" : "Taisez-vous donc, imbéciles. Vous ne savez pas ce qu'elle
vous coûtera, l'Alliance."
Personne heureusement n'a pu saisir un mot de la phrase.
L'attitude de mon chef est même prise pour un accès d'enthousiasme ; le vacarme
s'en élève d'autant et Develle, exaspéré, répète son "Taisez-vous
donc" en ponctuant d'un moulinet de sa canne qui écorne une aile de la
victoria. Cette fois, c'est du délire et nous rentrons assourdis par les
"Vive Develle, Vive l'Alliance". Lui se bloque dans son coin, son
"tube" sur les yeux, tandis que je prends le parti de saluer à sa
place, de mon bicorne, avec mes plus gracieux sourires.
A partir de ce moment, je vis dans mon uniforme que
j'endosse dès sept heures du matin, pour ne me déharnacher que le lendemain à
l'aube. Il fait heureusement un temps à souhait. Entre les déjeuners, les
banquets et les dîners somptueux, les galas dans tous les ministères, suivis de
réceptions en maints autres lieux, je saute jusqu'à mon cabinet où tombent des
avalanches de lettres de Russie, de France. Je reçois de tous les coins des
deux pays des demandes de souvenirs des fêtes, des brimborions que les camelots
vendent par charretées. On m'en demande de Sibérie, du Caucase, de Moscou comme
de Paris et des villages de Bretagne. Et toujours des colis arrivent à
l'adresse des Russes : services de table de Limoges, faïences de Lorraine,
toutes les spécialités de gâteaux, des conserves, tous les produits
gastronomiques de chaque province, jusqu'aux eaux minérales par caisses. Un
vieil officier russe m'écrit personnellement ; il a fait la campagne de Crimée
et voudrait découvrir un de nos officiers avec lequel il a échangé des
politesses dans les tranchées de Sébastopol.
J'ai composé, pour orner le menu d'un déjeuner au
ministère des Affaires étrangères, une vignette représentant une vue du palais
sur les jardins ; un de nos attachés m'ayant joué le mauvais tour de
communiquer aux journalistes ce menu avec indication de l'auteur, je reçus une
trombe de supplications pour obtenir de ces menus. Il eut fallu un tirage
spécial.

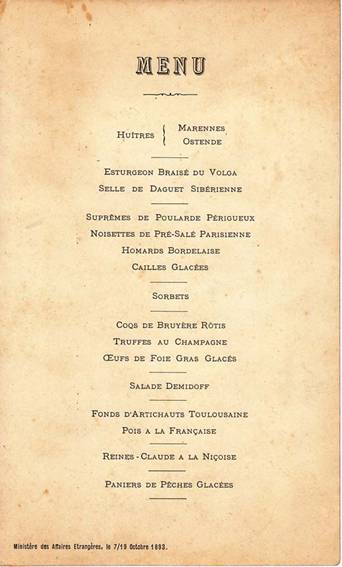
Nous nous nourrissons de foie gras, de truffes, de saumon
sauce verte et aussi de caviar. Nous sommes abreuvés de champagne à toute heure
de la journée comme de nuit. Nous buvons debout aux accents de la
Marseillaise et de l'hymne russe. Que de discours et quelle éloquence !
Nous roulons en landau au travers de cohues hurlantes qui ne doivent même pas
se coucher ; je fends encore des flots humains quand je regagne à l'aurore mon
domicile de Latour-Maubourg. On veut à tout prix voir les Russes, les toucher,
les embrasser. On se porte partout où ils doivent passer et même où ils ne
passeront pas. C'est une fièvre de folie qui met les gens dans la rue.
Le chargé d'affaires de Bavière, comte d'Aree, me conte
un jour que, rentrant d'une de ces réceptions, en uniforme militaire bavarois,
avec un superbe casque à chenille qui aurait bien dû le signaler allemand, il
s'était amusé à rentrer à pied, en prenant par les Boulevards ; il est
immédiatement naturalisé Russe, entouré ; on lui arrache les mains, on
l'embrasse, et le gros d'Aree, qui dans son accoutrement rappelait plutôt un
brave capitaine de pompiers, répondait : "Hé pien foui foui. Five la
Russie. Five la Russie". Il s'était beaucoup amusé. "C'est possible,
mon cher d'Aree, lui retournai-je, mais la saison n'est pas favorable pour
aller par les rues de Paris dans cette tenue ; c'est malsain. Si vous tenez à
faire prendre l'air à votre uniforme, promenez-le au moins en voiture."
Cependant ils n'ont rien d'enthousiasmant, nos hôtes qui
continuent à demeurer froids au milieu de cette ébullition. Nous-mêmes, assis
dans leurs carrosses, nous ne percevons pas la moindre expression de leurs
sentiments ; nous n'échangeons pas un mot. Nous promenons des bêtes curieuses.
Parmi tant de banquets, il en est cependant où l'on
jeûne. A celui des dix mille couverts, organisé par la Presse dans la Galerie
des Machines, je n'ai pu arracher que trois radis et un croûton à des serveurs
qui ne servaient point, occupés à grimper sur des chaises pour voir les Russes
exposés sur une estrade au fond de l'immense nef. Mon voisin, qui était Armand
Sylvestre, un auteur gai à mine funèbre, plus heureux, put s'attribuer quelque
chose ressemblant à une sardine. La vaisselle fabriquée tout exprès, marquée
d'un faisceau de drapeaux français et russes entrelacés, devait être emportée
en souvenir. Je pus glisser mon assiette dans les basques de mon uniforme sans
crainte de taches de graisse. Je me rattrapai ensuite par quelques tasses de
chocolat absorbées sur la toiture du Ministère, au pied du paratonnerre, où
Madame Develle avait fait porter un en-cas à ses invités pour le feu d'artifice
qui se tirait au Champ de Mars. On ne pouvait souhaiter une meilleure tribune
pour voir se déployer dans son ampleur ce feu d'artifice qui fut véritablement
une merveille.


Pour le banquet de l'Hôtel de Ville, ce fut encore plus
frugal ; il me fut impossible d'y parvenir.
Le Ministre, qui accompagnait Carnot, m'avait prié
d'escorter Madame Develle. J'avais jugé prudent de partir une heure d'avance.
Nous avions à peine dépassé la Concorde et pénétré de quelques mètres sur le
quai des Tuileries, que cette avance était épuisée. L'équipe de gardiens de la
paix qui attendait là la voiture ministérielle pour lui frayer sa voie dans une
mer humaine qui se refermait sur elle, se déclarait impuissante et nous
conseilla de retourner et de tenter le passage par la rive gauche. Les agents
eurent déjà une peine infinie à faire faire demi-tour à l'équipage et ils nous
abandonnèrent après nous avoir fait franchir le pont de la Concorde. Mais, du
faubourg Saint-Germain, comme de toutes les rues perpendiculaires à la Seine,
s'écoulaient des torrents de piétons qui venaient buter contre les quais.
Aucune voiture ne s'était risquée dans cette inondation ; la nôtre seule en
émergeait comme une épave. A dix heures, nous demeurions accrochés, bloqués en
face du pavillon de Flore, dans le remous des courants qui cherchaient à
traverser le pont. Nos chevaux étaient incrustés dans une masse impatiente que
nous irritions. Que pouvaient faire là ces gens qui, par dessus le fleuve,
n'apercevaient même pas les toitures de l'Hôtel de Ville, écrasés par la
poussée de tout ce qui venait à l'arrière de très loin ? Ce raz de marée
humaine fut vraiment un phénomène inimaginable, déchaîné par la présence dans
Paris de cette poignée de Russes si peu prestigieux.
L'alliance russe, dont ces fêtes n'étaient pourtant que
les préliminaires, soulevait l'imagination populaire et déterminait, non
seulement à Paris mais d'un bout à l'autre du pays, ce mouvement incroyable, et
tout spontané, car le Gouvernement n'avait rien fait pour transporter
l'opinion.
Il semblait que le poids qui oppressait la nation depuis
1870 était soudain retiré, qu'un avenir nouveau s'ouvrait et toutes les
poitrines se dilataient, éprouvant le besoin de crier, de hurler à l'unisson,
en acclamant ces alliés qui devaient nous délivrer d'une contrainte de
vingt-trois ans.
Le mouvement était tel et si unanime, en ces jours de
novembre[4]
1893, que chacun était comme jeté hors de chez soi ; ce qui explique que des
masses s'écrasaient jusqu'aux extrémités de la rue du Bac, par exemple, sans
espoir de plus s'approcher et de saisir une bribe de ce qui se passait place de
l'Hôtel de Ville. Et que devait-il en être dans les quartiers de la rive droite
!
Placé comme je l'étais au plein centre d'observation,
l'aspect et les sentiments de ces foules étaient bien curieux à étudier.
Jamais, par la suite, lors de la visite du Tzar lui-même, ni pour la
célébration de l'armistice en 1918 et pour les défilés de la victoire, on ne
revit pareilles affluences ni pareils transports unanimes. Tout, alors, était
espoir sans prévision de deuils et de désillusions.
Les
rangs pressés contre les roues nous lancent des quolibets et aussi quelques
injures. Un moment, certains mauvais plaisants saisissent les ressorts et
impriment à la voiture un roulis inquiétant. Madame Develle poussait des cris,
ordonnant au cocher de rentrer. Les chevaux très sages heureusement ne
bougeaient pas. Il faisait une nuit noire et ce ne fut qu'après assez longtemps
qu'on reconnut la livrée ministérielle. "C'est un ministre", dit
quelqu'un, et la voiture reprit son équilibre. Des femmes plongèrent la tête
dans l'intérieur du coupé où Madame Develle en grande toilette, demi-morte, se
tenait crispée. "Mais non, dit l'une, c'est pas un minisse, c'est une
dame." D'autres, à leur tour, passèrent la tête et déclarèrent : "Ah,
oui, c'est une dame ; elle est pas belle." Il était prudent de ne pas
laisser continuer sur ce ton. Je parvins à ouvrir ma portière et à me glisser
sur le quai. Mon uniforme ramène le respect. Je dis au cocher de se mettre à la
tête des chevaux et de veiller à ce qu'ils ne puissent blesser personne, que
nous passerions, comme tout le monde, la nuit sur place, et j'entamai avec
quelques bonnes gens une conversation qui devint tout de suite amicale. Ce ne
fut que tard après minuit que nous regagnâmes le Quai d'Orsay.
De toute la série des fêtes, ce fut, je crois, la plus
forte ruée de foules qui, de tous les points de Paris, convergèrent vers
l'Hôtel de Ville ; cependant tout se passa sans catastrophe, sans désordres,
sauf quelques inévitables étouffements, malgré que la police n'existât plus.
Les esprits étant pénétrés du même sentiment, remplis du même enthousiasme,
maintenaient la plus belle fraternité. Il est douteux que de pareils mouvements
populaires se reproduisent dans un tel calme.
Mac-Mahon[5]
vient à mourir au beau milieu des fêtes. Fâcheux contretemps ! Le Comité de la
Presse, qui a fini par imposer ses prétentions de direction, fait pression sur
le Gouvernement pour faire renvoyer les funérailles qui devaient être
nationales. Mais c'était compter sans le sympathique Morhenheim qui voit là
l'occasion de rembarquer son amiral. On a beau l'assurer que la France saura
taire sa douleur jusqu'après l'achèvement du programme en cours et le départ de
ses hôtes, il déclare que la Russie prend le deuil et il exige que ses marins
cessent de figurer dans les réjouissances. Il parle même de les renvoyer de
suite à leurs bateaux. Fureur des journalistes. Intervention gouvernementale.
Je fais la navette entre l'Ambassade de Russie et le Comité de la Presse qui
siège en permanence. Pour satisfaire Morhenheim, on enterrera Mac-Mahon et,
après un deuil de vingt-quatre heures, on rallumera les lampions. Les marins
russes marcheront derrière le cercueil du maréchal. Morhenheim est pris à son
propre piège ; on lui concède que ce sera autant de retranché du programme,
mais on continuera. La Presse elle-même est apaisée en faisant porter les
retranchements sur quelques numéros attribués à des chambres de commerce et
autres corporations et elle s'attribue en outre une figuration dans les
funérailles qu'on organise en vitesse.
Ce pacte conclu, avec Arthur Meyer, je cours une dernière
fois à l'Ambassade où je carillonne vers une heure du matin. J'y saisis
Morhenheim dans son lit et je lui fais signer, tout grinchant, ce nouveau
traité.
En hâte, Mac-Mahon est porté à la Madeleine ; le
Protocole improvise les pompes de circonstance. Et les manifestations -
j'allais dire les fêtes - reprennent.
A la Madeleine, un incident qui n'a figuré dans aucun
compte rendu. La cérémonie religieuse terminée, les employés des pompes
funèbres chargés d'enlever les couronnes laissent de côté celle de Guillaume II[6],
qu'ils refusent énergiquement d'emporter. Le comte de Munster, avec tout son
personnel, ses attachés militaires casqués de l'aigle impérial, montent la
garde auprès de l'immense gerbe de fleurs de leur empereur, tandis que le char
s'éloigne déjà. Impossible de décider les croque-morts. Pourtant il faut à tout
prix éviter une affaire qui prendrait mauvaise tournure ; les Allemands sont
plantés là, raides et rébarbatifs. Nous prenons quatre fantassins à qui nous
faisons déposer leurs fusils dans l'église et la couronne, sur une civière
spéciale, s'en va portée par des troupiers que suivent Munster et ses
cuirassiers blancs au pas de parade.
Le commandant de vaisseau Maréchal, représentant la
Marine, et moi, nous accompagnons le groupe des officiers russes. Jusqu'ici, on
ne les a aperçus que dans leurs landaus, au grand trot, entourés de cavalerie.
A les voir à pied, traversant la place de la Concorde bondée de monde, la foule
ne se tient plus ; les barrages craquent, les échelles des photographes
dégringolent. Le commandant Maréchal se jette d'un côté, moi de l'autre et,
montrant le corbillard dont personne ne se soucie, nous crions : "Attendez
; nous sommes en deuil. Au retour". Grâce à ce subterfuge, nous passons ;
mais que sera-ce au retour !
Dans la chapelle des Invalides, le vieux Canrobert,
dernier maréchal survivant, assis dans un fauteuil, en grande tenue de maréchal
du Second Empire, enveloppé dans des couvertures et coiffé d'une calotte noire
par dessus ses longs cheveux bouclés, assiste au service de son frère d'armes
comme à une répétition pour le sien propre. La cérémonie terminée, nous lui
conduisons le peloton de nos Russes qui défilent devant lui et le saluent, mais
il ne manifeste rien.
Après le défilé des troupes qui fut splendidement
empoignant, les soldats participant à l'enthousiasme national, restait à
réintégrer sans dommage nos hôtes au Cercle militaire ; c'est-à-dire sans en
perdre en route, car nous allions être pris d'assaut.
Nous tenons conseil, le commandant Maréchal et moi, sur
la stratégie à suivre pour opérer cette retraite. Mon plan est adopté : le
commandant prendra la tête du cortège dans le premier landau, moi, dans le
dernier ; un intervalle aussi court que le permettra l'allure entre chaque
voiture et en avant, à fond de train. Nous réussissons à tromper la foule en ne
repassant pas la Seine tout d'abord et en allant par les rues de la rive gauche
prendre le pont du Louvre où l'on ne nous attend pas. La traversée de la place
Vendôme se fait encore bien grâce à notre allure de charge. Mais, rue de la
Paix, c'est le désastre. Là, une foule stationne jour et nuit loin des abords
du Cercle militaire. Chaque arrêt d'une voiture immobilise le reste de la
colonne et comme je suis dans la huitième, nous sommes submergés. Des gens
montent sur les marchepieds, sur les roues, arrachent les mains des Russes avec
des cris frénétiques. On veut les toucher, les embrasser. Moi-même, malgré mon
uniforme différent, je deviens également Russe ; j'ai les bras tirés, je suis
embrassé par des hommes, des femmes, des mannequins des couturiers d'en face et
jusque par deux artilleurs de la territoriale.
Les obsèques de Mac-Mahon comprenant vingt-quatre heures
de deuil, nos Russes inoccupés ont liberté de manœuvre dont ils pensent
profiter pour circuler isolément dans Paris, en civil. Mais on redoute, et avec
raison, de les voir disparaître sans retour, envolés s'ils sont reconnus et on
ne les lâche dans la rue qu'accompagnés par des officiers français de l'Armée
et de la Marine, aussi en civil. Moi-même, je prends en charge quatre d'entre
eux, dont un neveu de Tolstoï, et je me double d'un aimable capitaine de
dragons.
Je conduis mon groupe dîner chez Larue où j'ai retenu une
table ; je retiens en outre une baignoire aux Variétés, malheureusement
en usant du téléphone du ministère. Par prudence je réclamais une baignoire
grillagée.
Chez Larue, nos invités demandent du caviar et une eau de
vie russe qui figure maintenant sur la carte de tout restaurant qui se
respecte. Tolstoï m'enseigne comment on ingurgite un plein verre de ce vitriol
d'un seul coup sec, en le lançant jusqu'au fond du gosier par une bouche
ouverte comme un four. Ces exercices attirent l'attention de nos voisins de
table qui ne tardent pas à nous repérer. La nouvelle se propage dans toute la
salle, formée de tablées des plus élégantes, puis monte à l'entresol et envahit
l'escalier. Tous les yeux sont sur nous ; les patrons, les garçons nous
entourent ; des verres se lèvent, tendus vers nous, accompagnés de gracieux
saluts féminins, des "Vive la Russie" en sourdine. Cela ne laisse pas
d'être gênant ; nous pressons le départ pour le théâtre.
Aux Variétés, lorsque je réclame au bureau la loge
retenue du ministère, les trois messieurs en habit se confondent en salutations
; ils ont l'ordre de prévenir le directeur qui arrive essoufflé. "Ces
messieurs sont bien russes, n'est-ce pas ?" - "Ah, pardon ! Nous
réclamons les places retenues ; en voici le prix. Je vous serai obligé de me
remettre le coupon." Impossible de garder l'incognito. Je n'obtiens que
cette transaction qu'on nous maintiendra dans la baignoire obscure au lieu du
centre du balcon déjà réservé à notre intention.
A peine dans notre box, les acteurs, dont Jeanne Granier
qui est en scène, fixent notre grillage ; les ouvreuses, les pompiers sont
tournés vers nous ; toute la salle suit le mouvement et l'acte est interrompu.
L'orchestre attaque l'hymne russe et nous voilà obligés de lever le grillage,
sous un tonnerre de vivats. Mes Russes sont encore plus en bois que dans leurs
uniformes et c'est à moi qu'il appartient de me pencher hors de la loge, de
saluer, d'agiter les bras dans toutes les directions, du poulailler au
parterre, comme un ténor bissé ; et je demande la Marseillaise. Nouveau
délire. Je passe évidemment pour Russe. On recommence l'acte, mais la scène est
dans notre loge. Nous sommes le clou de la soirée.
A l'entracte, une délégation des artistes vient nous
inviter à visiter le foyer. Jeanne Granier veut sans doute nous embrasser ;
l'affaire devient chaude. Cependant cette perspective enivrante nous est
enlevée par une autre délégation qui, celle-ci vient de l'autre extrémité du
Boulevard, du théâtre de l'Ambigu. Là, on avait préparé une réception
aux officiers russes ; des invitations avaient été lancées au Cercle militaire
et on espérait la venue de quelques uns. La direction de l'Ambigu ayant
appris, je ne sais comment, la présence de notre groupe aux Variétés,
nous faisait supplier de nous diviser pour lui envoyer quelques représentants.
En avant pour l'Ambigu ; épuisons toutes les joies.
Ici nous sommes exposés au beau milieu de la salle ; dès
notre entrée la représentation s'arrête, la troupe entière massée sur la scène
; spectateurs debout ; hurlements ; hymne russe, Marseillaise ; et je
recommence mes salutations au public, avec des plongeons, les mains sur mon
cœur. Mes Russes ne bronchent toujours pas.
Enfin nous les ramenons au complet. La fête pourra
reprendre son cours demain. Mais je commence à en avoir assez de ce rôle d'une
sorte de gardien du sérail. Si encore il s'agissait d'odalisques.
Enfin arrive la dernière soirée : le grand gala de
l'Opéra. Une salle archicomble naturellement, composée de toutes les illustrations
et de presque tous les mondes, le "demi" y étant représenté par les
plus belles étoiles des théâtres, aussi bien que le faubourg Saint-Germain le
plus "blanc" et trié aussi soigneusement que pour des invitations au
Trianon, d'après le nombre des quartiers. Oubli magnifique des barricades
politiques, du côté invitant comme du côté des invités. Tout le pays, en
vérité, se coudoyait sous les couleurs franco-russes. Quel coup d'œil, quelles
toilettes et des torrents de diamants ; peu d'habits et encore constellés de
décorations ; tous les corps officiels civils en uniforme. Le Protocole s'était
distingué par de savants groupements, des bouquets de beautés en renom et bien
mises en valeur.
Le demi cercle des Russes, au centre du parterre, faisait
seul une tache vert sombre, sans autres dorures que des galons de manches. Nos
officiers de marine qui les encadraient, dans leur splendide habit de cérémonie
d'alors, formaient un contraste un peu reluisant.
L'entrée du président Carnot nous procura une scène amusante.
Comme le Protocole l'attendait au pied du grand escalier, le Comité de la
Presse avait déjà pris possession de lui à sa descente de voiture et nous vîmes
Carnot avec sa mine triste, sa démarche d'automate, s'avancer entouré des
journalistes et précédé de deux de leurs membres éminents, dont Arthur Meyer,
portant chacun un candélabre à cinq branches, bougies allumées. C'était le juif
Meyer qui avait ressuscité ce cérémonial monarchique. A côté de moi, Lockroy[7],
ex-gendre de Victor Hugo, s'écria : "Oh ! le beau spectacle ; ça ne
s'était pas vu depuis Jésus-Christ". Le pauvre Carnot, en effet, avec son
teint bistre, ses gestes en bois et son air résigné, entre le juif Meyer et un
autre larron de Presse armés de leurs chandeliers à cinq branches - pourquoi
pas à sept -, gravissait l'escalier fameux, comme un calvaire.
La représentation elle-même fut magnifique : un acte de Faust
; la scène de la terrasse de Salammbô ; l'acte de la roue de Samson
; deux ballets, Sylvia et la Korrigane, interprétés par l'élite
de l'Opéra. A la chute du rideau : l'hymne russe chanté par la masse des
choristes soutenant les premiers rôles alignés devant la rampe, puis la
Marseillaise entonnée d'une manière frémissante par les voix de la Krauss,
de Rose Caron, de Gaillard et de tous les premiers sujets, eux-mêmes emballés.
Encore des acclamations, des applaudissements partant aussi bien de la scène
que de la salle. Je vois la Krauss surtout agitant ses bras de colosse dans un
transport effréné. Cela aussi ne s'était certainement pas vu depuis
Jésus-Christ.
Je crois bien que nos hôtes s'étaient endormis durant la
représentation. Les derniers vivats les soulèvent ; c'est le signal du départ.
On entend un rugissement rauque, arraché d'un gosier barbare "Vive la
Frrrrrance !" qui éclate comme une décharge de mousqueterie. C'est
l'amiral Avelane qui met le point final aux manifestations des douze derniers
jours. Et c'est tout. Je pousse un ouf de soulagement : on va pouvoir dormir ;
il n'y a plus de Protocole.
Nos Russes ont leurs voitures sur la place, leur train
est sous pression à la gare du P.L.M. ; chacun se précipite de son côté, sans
plus de cérémonie et l'on se quitte comme si l'on ne s'était jamais vu.
Le lendemain de cette mémorable soirée, je récupérais un
long arriéré de sommeil, bien résolu à pousser cette récupération loin dans la
journée et à laisser chômer les affaires de l'Etat, lorsque vers la onzième
heure, réveillé en sursaut, je vois avec effarement l'huissier de mon cabinet
qui me secouait sur mon lit. Le président de la République me réquisitionnait
pour l'accompagner à Toulon où il allait passer en revue l'escadre russe. Or,
le train présidentiel partait deux heures plus tard ; le temps d'empaqueter mon
uniforme et de sauter dans un des wagons présidentiels où je prenais place,
avec mon patron Develle et le ministre de la Marine comme camarades de lit.
L'amiral Rieunier était sans doute un fort bon marin,
mais comme causeur en voyage, quel merveilleux raseur ! Develle, qui le
connaissait sous ce jour, me joua la sinistre farce de le lancer sur moi, sous
le prétexte que, connaissant le Tonkin, j'entendrais avec plaisir l'histoire
"véridique" et les causes de la conquête de la Cochinchine à laquelle
l'amiral avait assisté dans sa jeunesse.
C'était, paraît-il, une scie en honneur parmi les membres
du Cabinet. On lui faisait raconter cette campagne, on pressait un bouton et le
brave amiral montait sur son bateau - c'est-à-dire qu'il en montait un fameux à
ses auditeurs, sans jamais se lasser - et faisait ainsi naviguer pendant six
heures, sans la moindre escale.
M'ayant ainsi livré à son collègue, Develle s'esquiva
lâchement pour s'aller coucher, assuré dès lors de disposer seul de notre
dortoir pour toute la nuit.
Ce ne fut qu'à Marseille que je pus me tirer du grappin
de l'Amiral qui, chaque fois que je pensais avoir enfin conquis l'Indo-Chine,
repartait : "Ah, j'oubliais ; il faut que je vous dise ..."
A Toulon, pagaille indescriptible. La population y avait
pour le moins quintuplé. Circulation impossible ; on couchait dans les cafés et
chez l'habitant. La Municipalité avait réquisitionné le plus grand hôtel, à la
disposition de ses invités officiels, avec table ouverte de nuit comme de jour.
Il avait été pris, envahi par la nuée des journalistes, naturellement. Pas un lit
de libre ; les couloirs, les paliers transformés en dortoirs. Je me réfugiai à
la Sous-préfecture où le malheureux sous-préfet et sa femme avaient dû céder
jusqu'à leur propre chambre au président du Conseil et passaient la nuit dans
des fauteuils. Du toit à la cave, tout était plein comme un œuf. Je trouvai à
m'allonger dans une soupente. J'avais bien songé au train présidentiel, mais la
gare était embouteillée et nos wagons se trouvaient remisés à une station
au-delà de Toulon ; ce qui me joua un fâcheux tour lorsque le moment venu de
remettre les décorations décernées pour la circonstance, les diplômes et écrins
dont j'avais charge ne se retrouvèrent pas, étant demeurés dans mon
compartiment.
Le programme comprenait la revue de la flotte russe et le
lancement d'un nouveau cuirassé, le Jauréguibérry. Embarquement à
l'escalier de l'Arsenal sur une flottille de chaloupes, par une mer assez
agitée qui nous couvrait d'embruns funestes pour nos dorures. J'avais pris
place dans une baleinière avec notre ambassadeur à Pétersbourg, de Montebello,
et nous nous faisions doucher au son de la Marseillaise alternant avec
l'hymne russe et sous le feu des canons, obligés pour contourner les navires de
prendre debout ou de flanc une houle qui embarquait par tous les bords.
Quelle collection de sabots, de rafiots, nous
présentaient nos alliés ! Pas deux unités semblables ; de vieilles coques
presque préhistoriques. Si c'était là les forces d'appui, il y avait de quoi
déchanter. C'est un sentiment que renforça en nous l'amiral de Boissoudy,
commandant en chef de notre escadre, lorsque après le lancement - très réussi -
du Jauréguibérry, il nous ramena sur son impressionnant Redoutable
pour y prendre le thé. Par les fenêtres de son salon, entre les culasses de
deux pièces énormes, supérieurement ripolinées en blanc, on embrassait la
piteuse petite escadre de l'amiral Avelane et je commençais à m'expliquer
l'accès de fureur de Develle à sa sortie de l'Elysée.


Manœuvres navales devant Toulon

Lancement du « Jauréguiberry » à
Toulon
Il en fut à Toulon comme à Paris. C'est au pas de course
que les deux parties se tournèrent le dos, sitôt tiré le dernier coup de canon,
sans salamalecs d'adieux ni d'au revoir.
L'amiral de Boissoudy avait hâte de conduire, dès le soir
même, ses équipages à la mer pour les reprendre en main, après plusieurs
semaines de soûleries patriotiques et de fraternisation avec leurs camarades
russes qui, dans le genre, étaient d'un exemple bien malsain pour les nôtres.
De leur côté, les navires russes levaient l'ancre,
laissant à terre de nombreux manquants. On en ramassa tout au long de la côte,
cuvant des cuites homériques et nous eûmes à les renvoyer en Russie par le
chemin de fer, en même temps que les wagons de cadeaux qui continuaient encore
de s'accumuler.
Pour le retour à Paris, notre troupe autour du président
s'était allégée des éléments marins et des parlementaires ; nous voyagions
confortablement, au large, en petit comité, très intimement. Nous ne formions
qu'une table composée du président, de Dupuy, président du Conseil, Develle,
ministre des Affaires étrangères, de Montebello, ambassadeur, le général Dubois
et moi.
Aux faubourgs de Lyon, notre train fut détourné pour
éviter la traversée de la ville ; nous étions à déjeuner et l'on stoppa quelques
instants en pleine voie, près d'une petite agglomération. En un instant, tout
ce qu'il y avait là de gens accourut sur les rails et nous tendait les mains en
montant sur les marchepieds. Je fis l'observation qu'un attentat serait, dans
ces conditions, bien facilement commis. Carnot me répondit textuellement :
"Mais mon ami, pourquoi m'assassinerait-on ? Je ne suis rien, moi. Si on
devait supprimer quelqu'un, tenez, ce serait Dupuy", en se tournant vers
le président du Conseil. - Moins d'un an plus tard, dans la cathédrale de
l'Assomption, au Paraguay[8],
je faisais célébrer un service à la mémoire du président Carnot, assassiné dans
ce même Lyon que la Sûreté générale nous faisait éviter en ce moment.
Pauvre président Carnot. J'avais eu l'occasion en 1889,
au cours de l'Exposition, de le promener dans ma section de l'Indo-Chine et je
l'avais amusé, autant qu'il pouvait l'être, par quelques anecdotes tonkinoises.
Il se souvenait de moi en 1893 et, durant ces fêtes russes, il me manifesta une
faveur particulière qui me toucha. C'était un homme infiniment bon et extrêmement
propre, remplissant avec dignité des fonctions dans lesquelles il se ruinait
d'ailleurs et qui lui avaient été imposées. Il savait n'être qu'un soliveau ;
il en souffrait mais il n'avait aucune velléité de sortir de ce rôle
constitutionnel, se bornant à représenter honorablement l'Etat.
J'eus l'occasion cependant de le voir
regimber et refuser sa signature au bas de décrets que lui présentaient ses
ministres quand il s'agissait de nominations ou de décorations de gens tarés.
Je le vis une fois, les larmes aux yeux, écrire de sa
main et signer une lettre adressée au Tzar, le "Cher et grand Ami", à
la suite de manigances de son ambassadeur, le juif Morhenheim, qui prétendant
avoir été traité sans égards et même insulté, exigeait des sortes d'excuses.
Alexandre III avait alors déclaré qu'il ne recevrait plus de Montebello avant
que cette réparation vraiment humiliante n'eut été accomplie. La lune de miel
de l'Alliance n'allait pas sans querelles de ménage qui jetaient une douche
froide, après l'emballement des fêtes russes. Il fallut, dans cette
circonstance, l'intervention de la princesse Waldemar de Danemark, fille du duc
de Chartres, pour instruire le Tzar des menées de Morhenheim contre l'Alliance
et amener le remplacement de ce juif boche à l'ambassade de Paris.
Auguste François

Décoration
russe de St Stanislas décernée à A. François